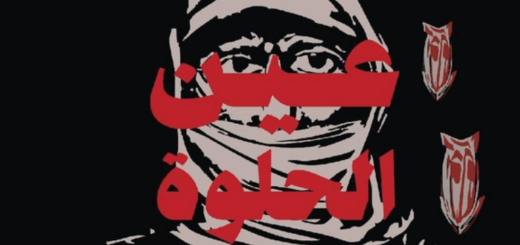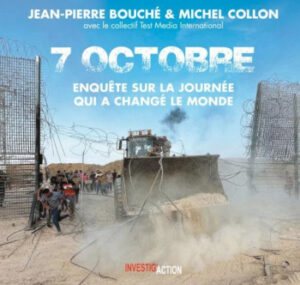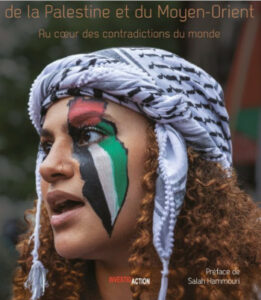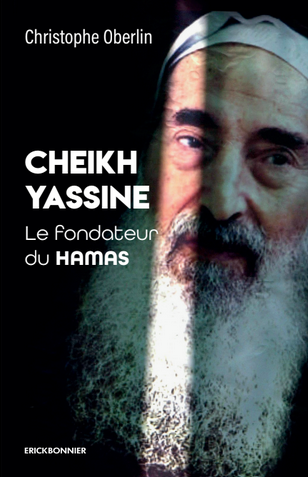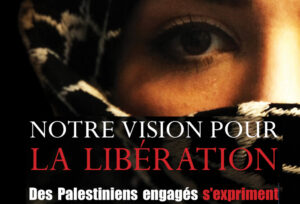Ziad al-Rahbani (1956-2025) : La voix inflexible de la résistance et de la révolution
« Si le système ne fonctionne pas, changez-le. » – Ziad al-Rahbani, « al-Nizam » (Le système)

Ziad al-Rahbani, un pilier de la musique radicale, est décédé à 69 ans. (Photo : via AJA)
Louis Brehony, 27 juillet 2025
C’est avec stupeur, vu la précocité de son départ, que le Liban fait ses adieux à Ziad al-Rahbani, un pilier de la musique radicale, à l’âge de 69 ans. Communiste engagé lui-même aligné sur la cause palestinienne, Ziad a laissé ses empreintes musicales indélébiles à des générations d’auditeurs, de musiciens et d’activistes. Ziad ébouriffait les plumes des riches, embarrassait les conservateurs et irritait les libéraux. Fils des icônes libanaises Faïrouz et Assi Rahbani, sa ténacité musicale et sa critique d’un système en crise exigeaient que d’autres chantent également sa chute.
Né dans un cadre relativement privilégié parmi des chrétiens maronites et des musiciens de renom, il était logique que Ziad emprunte une voie créatrice dès son tout jeune âge. Assi, son père compositeur, et Mansour, son oncle, étaient les fameux frères Rahbani, qui ont composé des œuvres marquantes pour sa mère Faïrouz, à ce jour la chanteuse la plus renommée du Liban. Ziad a grandi en assistant aux répétitions et a rencontré d’énormes personnalités de la musique arabe, dont le compositeur égyptien Mohammed Abdel Wahab et le Palestinien Sabri Sherif, qui ont produit les albums de Faïrouz dédiés à la Palestine. Finalement, Ziad a hérité du manteau de Rahbani et, à partir des années 1980, il est devenu le principal auteur-compositeur de Faïrouz.
Adolescent, Ziad a rejoint les productions des frères Rahbani et a tranquillement appliqué ses compétences comme compositeur et claviériste. Bien que son approche de l’héritage de ses parents n’ait pas été la politique de terre brûlée décrite par certains, Ziad s’est mis à bâtir sa propre voie. Attiré par la politique de gauche à une époque où le Parti communiste libanais (PCL) s’était allié à la résistance palestinienne, l’empathie de Ziad envers les pauvres et les opprimés s’est exprimée rapidement via la musique. Il a trouvé sa raison d’être dans le théâtre musical et des œuvres comme Film Amriki Tawil (Un long-métrage américain, 1980) et Chi Fechil (Le fiasco, 1983) brisaient des tabous sociaux en attaquant avec virulence la discrimination de classe et en mettant en lumière des personnages de la classe ouvrière.
Dégoûté par le massacre du camp de réfugiés de Tel al-Zaatar, en 1976, Ziad a quitté le confort matériel de Beyrouth-Ouest et a choisi de résider dans des quartiers à majorité musulmane. Tout au long des invasions sionistes et d’une guerre qui allait durer 15 ans, il a refusé de quitter le pays et de chercher refuge ailleurs. Attestant de l’atmosphère radicale dans laquelle il était entré, Ziad a composé la bande du film Retour à Haïfa (1982), tiré du roman de Ghassan Kanafani, produit par le dramaturge radical Kassim Hawal et impliquant le soutien de l’Allemagne de l’Est socialiste.
En 1985, avec le conservatisme et le sectarisme émanant de la destruction des invasions et de la guerre, Ziad a publié Ana Mish Kafir (Je ne suis pas un infidèle). La plage titre attaquait les personnes des communautés chrétiennes et musulmanes du Liban qui se lavaient les mains des problèmes affrontés par les pauvres et les opprimés :
« Je ne suis pas un infidèle, mais la faim si
Je ne suis pas un infidèle, mais la maladie si
Je ne suis pas un infidèle, mais la pauvreté si »
Reprise dans le même album, la chanson de Ziad, « al-Muqawama al-Wataniyya al-Lubnaniyya » (la Résistance nationale libanaise) était empreinte d’optimisme révolutionnaire et prophétisait de futures victoires. Elle allait être chantée plus tard par Faïrouz au festival de Beiteddine en 2000, marquant l’expulsion des forces israéliennes des œuvres de la résistance :
« Si le sud reste debout, ses enfants resteront debout aussi »
Nombre des chansons politiques écrites par Ziad pour le théâtre et nombre d’albums couvrant cette période des débuts ont trouvé depuis lors une pertinence frappante pour la vue des nouvelles générations venues depuis lors. Dans « Shu Hal Ayyam » (Nous en sommes arrivés à une époque), les paroles de Ziad constituaient une critique directe du capitalisme :
« Nous en sommes arrivés à une époque
Où ils disent que les riches donnent aux pauvres
Comme si l’argent s’envolait de lui-même
À celui-ci une pincée, à celui-là un paquet
Quelle bonne époque ! »
Le joueur d’oud de Gaza, Reem Anbar, a joué cette chanson et il en dit :
« Elle résonne toujours en nous aujourd’hui, alors que nous voyons l’injustice et l’inégalité tout autour de nous. Ziad a vraiment donné voix à notre expérience en Palestine et à Gaza en particulier. »
Survenu en plein génocide de Gaza, le décès de Ziad le 26 juillet a donné lieu à un élan collectif de musiciens et d’activistes politiques. Le musicien égyptien Hazem Shaheen avait joué avec Ziad dans ses dernières années, y compris sur les scènes du PCL. Attristé par la perte d’« un ami et d’un être humain de l’ordre le plus élevé », Hazem a déclaré qu’il ressentait la traduction des engagements politiques de Ziad dans la façon dont il traitait autrui :
« Au niveau personnel, il était exceptionnellement altruiste, intéressé dans le soutien et l’encouragement d’artistes plus jeunes plutôt que motivé par sa propre carrière. »
Le parolier libanais Fadi Zaraket perçoit dans le décès de Ziad une importance similaire à celle de la perte du chef du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah :
« Une perte énorme pour la musique, la culture, les médias et la résistance révolutionnaires. »
Ziad était apparu en public en tant que commentateur politique, ces dernières années, dénonçant l’intervention occidentale en Syrie et critiquant la corruption bourgeoise au Liban. Selon le Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) :
« Ziad Rahbani était plus qu’un artiste ; c’était une conscience nationale vivante et un intellectuel engagé dans les causes de son peuple, choisissant toujours le camp des pauvres et des marginaux, rejetant l’injustice, la tyrannie et le sectarisme (…) Il n’a jamais été neutre. Au contraire, il soutenait les pauvres, les gens, la Palestine, Gaza et les révolutionnaires qui ne demandaient rien d’autre qu’une patrie qui ne soit pas à vendre, ainsi qu’une vie sans humiliation. »
*****
 Louis Brehony est musicien, activiste, chercheur et enseignant. Il est l’auteur du livre « Palestinian Music in Exile: Voices of Resistance » (Musique palestinienne en exil : les voix de la résistance) (2023). Il est également éditeur de « Ghassan Kanafani: Selected Political Writings » (GK : Choix d’écrits politiques) (2024) et directeur du film primé « Kofia: A Revolution Through Music » (Kofia, une révolution par la musique) (2021). Il écrit régulièrement sur la Palestine et sur la culture politique et se produit sur scène au niveau international comme joueur de bouzouki et guitariste.
Louis Brehony est musicien, activiste, chercheur et enseignant. Il est l’auteur du livre « Palestinian Music in Exile: Voices of Resistance » (Musique palestinienne en exil : les voix de la résistance) (2023). Il est également éditeur de « Ghassan Kanafani: Selected Political Writings » (GK : Choix d’écrits politiques) (2024) et directeur du film primé « Kofia: A Revolution Through Music » (Kofia, une révolution par la musique) (2021). Il écrit régulièrement sur la Palestine et sur la culture politique et se produit sur scène au niveau international comme joueur de bouzouki et guitariste.
Lisez du même auteur : Quand Oum Kalthoum chantait pour la Palestine
*****
Publié le 27 juillet 2025 sur The Palestine Chronicle
Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine

Ziad Al-Rahbani montrant la photo Georges Abdellah au Centre culturel Marouf Saad à Saida, le 27 octobre 2018.