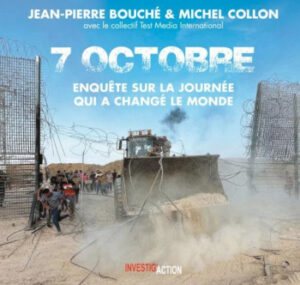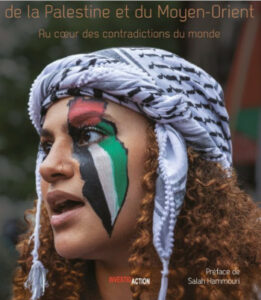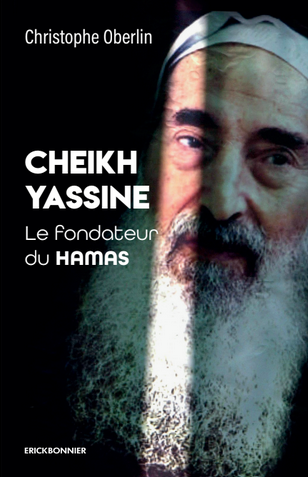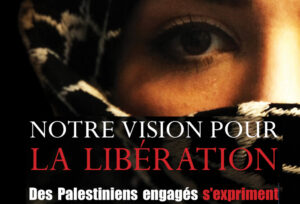Des réfugiés palestiniens envoyés dans des centres fermés sur des bases controversées
Entre le 3 et le 10 septembre, quatre demandeurs d’asile palestiniens impliqués dans les protestations organisées à la Bourse de Bruxelles contre le génocide à Gaza ont été arrêtés et transférés vers des centres de détention fermés.

La force motrice des manifestations à Bruxelles, ce sont les réfugiés palestiniens, principalement de Gaza (Photo : Nadine Rosa Rosso)
Layla El-Dekmak, 25 septembre 2025
La motivation de la police ? « Trouble de l’ordre public », une justification trop souvent évoquée.
« Du fait qu’il n’existe pas de définition claire de ce qu’est précisément cet ‘ordre public’ et de ce qu’on peut entendre par ‘troubler’, il y a pour l’instant trop peu de sécurité juridique. »
Manifester est un droit. En démocratie, c’est une méthode valable en tant que moteur de progrès social et de changement. La force motrice qui sous-tend les manifestations à Bruxelles, ce sont les réfugiés palestiniens, principalement de Gaza. La plupart ont encore là-bas de la famille et des êtres chers. Ils ne sont pas séparés de l’horreur, ils en font intimement partie. Depuis deux ans déjà, chaque soir, à 19 heures, ils viennent se rassembler à la Bourse en compagnie de citoyens belges afin de réclamer la fin du génocide.
Les arrestations ont eu lieu pendant et après ces manifestations. Sur les médias sociaux circulent des vidéos des arrestations, comme celle de Husam (1) au métro à la Bourse. Sur les images, nous voyons deux agentes de police en civil qui exigent de voir sa carte d’identité. Quand Husam et les passants demandent pourquoi – ce qui est leur droit – deux agents en civil se précipitent sur le groupe. L’un est armé d’une matraque et l’autre de spray au poivre. Husam est emmené en coup de vent à l’extérieur, où plusieurs agents en uniforme l’attendent et l’emmènent.
Les quatre jeunes hommes – Husam, Anas, Fathi et Hamoudi – ont été transférés vers des centres fermés différents : le 127bis, Merksplas, Vottem et Bruges. Ils y sont restés enfermés pendant plusieurs jours, sans la moindre information. L’un des jeunes hommes a été arrêté le 3 septembre et transféré vers un centre de détention fermé. Ce n’est que le 15 septembre que lui et son avocat ont été informés de l’une des motivations de l’arrestation. Pour accéder au dossier complet, il leur a fallu attendre 16 (seize) jours. Pendant tout ce temps, le jeune homme est resté enfermé.
Apache s’est entretenu avec lui au centre même, durant cette période d’incertitude.
« Je suis fatigué, mentalement fatigué »,
a-t-il raconté.
« Je suis le plus jeune, ici, au centre. Je ne me suis jamais senti dans cet état. La seule chose que je vois, ce sont des murs. Et ce qui me rend malade, c’est que je ne sais pas grand-chose de mon affaire, ni quand je pourrai m’en aller, ni combien de temps je vais devoir rester ici. »
« Ce qui me fait le plus mal, c’est l’injustice, car je suis parti de Palestine, où j’ai été opprimé, dans le but de trouver la liberté, et tout ce que j’ai vécu ici jusqu’à présent, c’est plus d’injustice encore. »
Le souci de réduire les manifestants au silence est international. De l’Allemagne à la France et au Royaume-Uni, les manifestations propalestiniennes sont opprimées et l’État se met à l’œuvre de façon répressive. Au Royaume-Uni, depuis l’interdiction du réseau Palestine Action (le 5 juillet 2025), il y a déjà eu plus de 1 500 arrestations. Quelque 138 plaintes ont été introduites et le Ministère public a admis qu’il y en aurait encore bien davantage à l’avenir.
L’absence d’un cadre juridique
Initialement, les quatre jeunes hommes palestiniens n’ont pas été informés des raisons de leur arrestation, jusqu’au moment où une motivation spécifique leur a été communiquée : trouble de l’ordre public.
En Belgique, ce « trouble de l’ordre public » est un motif juridique très chargé, sur base duquel des personnes sont arrêtées. Quand la police l’invoque comme motivation, en l’étayant de plusieurs PV, il convient de ne pas en sous-estimer les implications, surtout pour les personnes en procédure d’asile.
Cela rend possible, entre autres, d’accélérer certaines procédures – telle l’expulsion –, mais aussi de réduire certaines garanties. L’accusé risque notamment une interdiction d’entrée, qui ne lui permet plus de venir en Europe pendant un certain laps de temps, l’obligation de purger sa procédure dans un centre ferme ou encore le rapatriement.
Selon Myria, le Centre fédéral Migration, un cadre juridique solide fait défaut. Il n’y a pour l’instant pas de définition juridique claire du « trouble de l’ordre public » et encore moins d’analyse pertinente de la notion.
Le centre de connaissances dénonce cette pratique depuis 2013 déjà. Dans ses recommandations, il écrivait à l’époque que la notion d’ordre public a besoin de critères objectifs et d’une définition claire :
« Ces critères doivent permettre une évaluation complète et détaillée de la proportionnalité de la mesure prise au nom de l’ordre public, en tenant compte du comportement de la personne, de ses droits fondamentaux et des liens qu’il a avec la société belge. »
Selon Myria, un cadre juridique plus solide est nécessaire pour empêcher une utilisation arbitraire.
On n’a pas écouté ces recommandations. Plus fort encore : La plainte semble être largement applicable aux personnes qui se trouvent illégalement ici ou qui ont une procédure d’asile en cours. Par exemple : Quelqu’un qui travaille en noir durant une procédure d’asile et qui est pris lors d’une inspection, peut voir figurer « trouble de l’ordre public » dans son dossier. Une Syrienne de 65 ans affligée de graves problèmes médicaux et qui entre en Belgique par avion avec un faux passeport (parce qu’il n’existe pratiquement pas de manières légales de le faire) peut être arrêtée à l’aéroport pour « trouble de l’ordre public ». Mais ce motif peut également être utilisé contre quelqu’un qui se livre à de graves actes criminels. Les conséquences possibles sont les mêmes pour chacune de ces personnes.
L’Office des étrangers (OE) peut décider de transférer cette personne vers un centre fermé et la rapatrier ensuite. La police décide d’arrêter quelqu’un, parce qu’il commet des faits répréhensibles ou qu’il n’a pas de documents de séjour.
Quand un non-Belge est arrêté, l’OE en est toujours informé. Le service examine dans le dossier spécifique s’il s’agit de quelqu’un sans permis de séjour. Dans ce cas, l’OE peut donner l’ordre de quitter le territoire ou de détenir la personne dans un centre fermé.
« Cette décision est toujours solidement motivée »,
explique Paulien Blondeel, porte-parole de l’OE.
« La priorité dans les centres fermés repose sur l’ordre public et la sécurité. Pour cela, l’OE s’appuie toujours sur le dossier de la police. Si un PV est présent dans le dossier et qu’il en ressort que des faits relatifs à l’ordre public ont été commis, l’OE prend ces faits en considération. »
« Dans ces arrestations à la Bourse, la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles avait demandé l’appui de l’OE sur le terrain, du fait que certaines personnes avaient commis des faits en marge de la manifestation. »
C’est l’État qui crée la vulnérabilité
De même Thomas Willekens, porte-parole de Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Travail avec les réfugiés – Flandre), reconnaît le problème qu’il y a avec la qualification de « trouble de l’ordre public ».
« Du fait qu’il n’existe pas de définition claire de ce qu’est précisément cet ‘ordre public’ et de ce qu’on peut entendre par ‘troubler’, il y a pour l’instant trop peu de sécurité juridique. »
Surtout, ajoute Willekens, du fait aussi que c’est la Belgique elle-même qui crée ce « trouble ».
« Les gens se retrouvent dans des situations de vulnérabilité qui sont créées par l’État. En refusant l’accueil, en accroissant l’insécurité, ces personnes sont plongées dans la précarité. »
On pourrait prétendre qu’en niant les droits fondamentaux des demandeurs d’asile, l’État belge force ou incite ces mêmes personnes à « troubler l’ordre public » afin de les criminaliser ensuite pour la chose. C’est ainsi que naît un cercle vicieux. Cette criminalisation de la migration s’inscrit dans le changement de paradigme de ces dernières années dans lequel les demandeurs d’asile sont de plus en plus perçus comme dangereux, comme une nuisance. Alors que cette nuisance est situationnelle et créée de toutes pièces et qu’elle n’est pas une caractéristique inhérente aux personnes en question.
En 2024, fait remarquer Myria après une analyse des chiffres de l’OE, il y a eu 28 258 arrestations administratives de non-Belges, pour lesquelles, dans 37 % des cas, il était question de « trouble de l’ordre public ». Dans 7 % des cas, la personne a été transférée dans un centre fermé.
En dehors de la police, personne, pas même les gens qui doivent se charger de la protection de ces personnes, ne sait précisément ce qu’implique cet ordre public, ni de qui il s’agit précisément. C’est à tout le moins inquiétant.
Myria se pose des questions à propos de la proportionnalité. Quelqu’un qui, dans le temps, alors qu’il était demandeur d’asile, s’est fait pincer parce qu’il voyageait en bus sans titre de transport, porte toujours dix ans plus tard l’étiquette de « trouble de l’ordre public » et est toujours perçu comme un « danger pour la société ». C’est une accusation grave. D’après la loi, il doit s’agir de quelque chose d’actuel et de proportionné. Est-ce toujours le cas ?
Pas la moindre preuve tangible
Quand les avocats des demandeurs d’asile palestiniens peuvent enfin prendre connaissance du dossier, la motivation officielle dans deux des arrestations dit que « la protection de l’ordre public l’exige ». Elle est suivie par la déclaration disant que l’OE a reçu l’information de la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles selon laquelle cette dernière a rédigé plusieurs PV, entre autres, pour incitation à la discrimination, rébellion et menaces.
Il s’agit de deux personnes différentes, mais la police utilise exactement la même motivation. Et mentionne chaque fois :
« Considérant la répétition de ces faits et leur impact social, on peut déduire que, par son comportement, la personne concernée est considérée comme susceptible de nuire à l’ordre public. »
Dans tout le dossier, il n’y a aucune trace de ces PV qui ont mené à cette conclusion. Bref, il n’y a pas la moindre preuve tangible. Dans les quatre cas, les réfugiés palestiniens ont obtenu gain de cause et le juge a ordonné leur remise en liberté. Mais, dans les quatre cas, un appel a été interjeté et dans deux cas au moins par l’OE. Malgré la décision du juge, les quatre hommes sont toujours détenus dans les centres fermés.
Ce qui complique encore les choses pour ces réfugiés palestiniens, c’est la tension entre, d’une part, la politique bruxelloise et la police et, d’autre part, les manifestants. Le bourgmestre Philippe Close (PS) a déjà fait allusion plus tôt aux manifestants en les dépeignant comme « ceux qui prennent le centre-ville en otage », et il aimerait beaucoup voir les protestations se dérouler en un autre endroit. Nous avons demandé une réaction à Close via son responsable de presse, mais notre question est restée sans réponse.
La police intervient sur base régulière, et de façon violente. Elle engage des autopompes, fait un usage excessif du gaz lacrymogène et elle a arrêté plusieurs manifestants, surtout palestiniens. En ce moment courent diverses plaintes à la zone de police pour violence policière dans le cadre des protestations.
À coup sûr, l’un des quatre demandeurs d’asile palestiniens arrêtés a deux plaintes en cours à la police pour violence policière et, dans les deux cas, les personnes parlent d’une arrestation qui s’est déroulée dans une extrême violence, l’une en 2024 et une autre en 2025. Une enquête interne a été ouverte.
Le dossier a également été adressé à la Ligue belge des droits de l’homme par le déposant.
« Ce que nous voyons ici ne manquera pas son effet »,
a déclaré sur VRT NWS Kati Verstrepen, présidente de la Ligue, à propos des arrestations.
« Cela dissuadera sans aucun doute les gens de faire entendre leur voix s’ils savent qu’ils courent le risque d’être enfermés. »
*****
Layla El-Dekmak est journaliste indépendante. Elle écrit pour différents médias, présente l’émission de radio « Reis Rond de Wereld » (Voyage autour du monde) sur Radio 1 et travaille actuellement sur son propre documentaire audio.
*****
Publié le 25 septembre 2025 sur Apache
Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine
*****
(1) Husam a été finalement libéré le 25 septembre

Lisez également : Arrestations en série de réfugiés palestiniens de Gaza à Bruxelles

Une délégation de Charleroi pour la Palestine au rassemblement à la Bourse
Dans la soirée du lundi 21 avril, le coordinateur européen de Samidoun, réseau de solidarité avec les prisonnier.ères palestinien.nes, Mohammed Khatib, avait également été arrêté par la police belge dans une rue du centre de Bruxelles. Il venait de quitter la manifestation devant la Bourse. Mohammed est un réfugié palestinien, né dans le camp de réfugiés de Aïn el-Helweh au Liban.
Mercredi 6 août, Mohammed Khatib s’est vu notifier la révocation de son statut de réfugié par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides.

Soutien aux réfugiés palestiniens enfermés et à Mohammed Khateb à Charleroi