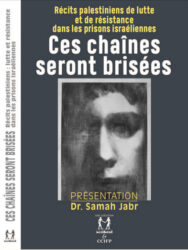Susan Abulhawa est une romancière palestino-américaine et une analyste politique née de parents réfugiés de la guerre de 1967.
Son premier roman, Les matins de Jénine, l’histoire de plusieurs générations d’une même famille dans le contexte de l’occupation de la Palestine par Israël, est devenu un best-seller international et a été traduit en vingt-six langues.
Abulhawa rédige régulièrement des tribunes sur l’occupation actuelle de la Palestine et elle est l’une des signataires du Mouvement Boycott, Désinvestissement & Sanctions (BDS).
Le deuxième roman d’Abulhawa, Le bleu entre le ciel et l’eau, a été publié fin 2015. Très récemment, elle se trouvait à New Delhi pour prendre la parole dans le cadre de « La Palestine en Inde : Un colloque d’écrivains », un événement accueilli par l’organe de presse féministe Women Unlimited. Voici quelques extraits d’un entretien.
Pouvez-vous nous parler de la genèse de votre organisation, « Playgrounds for Palestine » (Aires de jeux en Palestine) ?
Je suis retournée en Palestine en l’an 2000, après en avoir été éloignée pendant très longtemps. Ma fille était toute petite, à l’époque, et c’est ainsi que les terrains de jeux aux États-Unis occupaient une grande part de nos existences. L’absence d’aires de jeux en Palestine était quelque chose qui se faisait fortement ressentir.
Et, ainsi donc, j’ai monté cela sans grande planification – comme tout ce qui fait ma vie et, habituellement, cela se solde par un désastre – mais, cette fois, ça s’est déroulé merveilleusement. Ç’a été beaucoup plus difficile que je ne m’y étais attendue. J’ai brusquement été confrontée à toutes ces paperasseries qu’il me fallait remplir. Mais, une fois que nous avons été lancés, je n’ai plus voulu arrêter. C’est un travail d’amour et nous sommes une organisation composée exclusivement de bénévoles, et nous voulons que cela reste ainsi. Jusqu’à présent, nous avons aménagé vingt-huit aires de jeux et nous finançons plusieurs projets pour l’enfance, un projet théâtral, et encore quelques terrains de jeux supplémentaires.
Il y a cette histoire douloureuse de votre interdiction d’entrée en Palestine la dernière fois que vous avez essayé de vous y rendre. Pouvez-vous nous dire ce qui s’est passé ?
Oui, l’été dernier, je n’ai pas pu entrer en Palestine. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne vous le disent pas, ils n’ont pas à vous le dire. Ils ont le pouvoir de faire ce qu’ils peuvent.
C’est très pénible et, en même temps, on se sent coupable de s’en plaindre, parce qu’en Palestine, les enfants se font abattre en pleine rue. Et, ainsi, vous voulez hurler à ce propos mais, en même temps, vous devez également vous taire.
Comment êtes-vous passée au journalisme et à l’écriture après avoir eu un emploi dans une société pharmaceutique ?
J’avais toujours écrit, mais je ne voyais pas en tant qu’écrivaine. C’était quelque chose de très intime.
Pendant la deuxième Intifada, j’étais tellement mécontente des informations proposées dans les médias traditionnels américains, c’était si, si déformé…
Et c’est ainsi que j’ai adressé quelques lettres au rédacteur en chef, puis je me suis mise à rédiger des éditoriaux. À ma grande surprise, ils ont été publiés. J’ai continué à écrire et, finalement, j’en ai rédigé suffisamment pour mécontenter mes employeurs. J’ai fini par perdre mon emploi. J’étais anéantie, parce que je ne savais que faire.
J’étais mère célibataire et je n’avais pas d’économies. Je n’avais pas gagné beaucoup d’argent, dans mon premier emploi. J’ai pleuré toute la journée puis, le lendemain matin, je me suis assise pour me mettre à écrire.
Durant cette période, alors que j’écrivais, j’ai repensé à un voyage que j’avais effectué à Jénine et je me suis rendu compte que j’étais en train d’écrire un roman. J’ai hypothéqué ma maison et me suis enfoncée dans de grosses dettes. C’est quelque chose de vraiment stupide, pour une mère isolée, d’agir de la sorte mais, heureusement, en fin de compte, tout s’est bien passé pour moi. Et c’est comme cela que j’ai réorienté ma vie.
À l’époque, vous êtes-vous demandé si votre premier roman Les matins de Jénine allait connaître le succès ?
En fait, non. Pour être honnête, c’est bizarre que je ne me sois pas demandé si ça allait marcher, et c’est tout aussi bizarre que je ne me sois jamais demandé s’il allait être publié. Je ne savais rien à propos de cette industrie. J’ai été décontenancée quand, tout d’abord, je ne suis pas parvenue à le faire publier, mais j’ai toujours pensé que ça allait s’arranger. Cela n’importait pas vraiment, franchement. Mon seul but véritable, c’était de l’écrire.
Après l’avoir écrit, je devais retrouver du travail. J’avais besoin de gagner de l’argent et c’est ainsi, en quelque sorte, que j’ai laissé le livre de côté. Mais, quand vous créez quelque chose, cette chose fait son propre chemin dans le monde. Un livre, c’est comme un enfant, en ce sens. Moins d’un an plus tard, j’avais un agent à Barcelone et d’autres choses ont commencé à affluer vers moi. Je commencé à être traduite dans plusieurs langues.
De tout ce qui a disparu, les œufs Kinder sont ce qui me manquait le plus. Quand les murs se sont refermés sur Gaza et que les conversations des adultes sont devenues plus animées et plus tristes, j’ai éprouvé la dureté du siège que nous subissions par le nombre à la baisse de ces délicats œufs en chocolat, emballés dans du papier alu coloré, avec de splendides jouets surprises couvant à l’intérieur des œufs sur les étagères du magasin. Quand ils ont finalement disparu et que le métal rouillé de ces étagères est réapparu à nu, j’ai compris que les œufs Kinder avaient apporté de la couleur dans ce monde. En leur absence, nos vies devenaient d’un sépia métallisé, puis se diluaient en noir et blanc, de la façon dont le monde apparaissait dans les vieux films égyptiens, quand ma téta (grand-mère) Nazmiyeh était la gamine la plus effrontée de Beit Daras.
Même après qu’on eut creusé les tunnels sous la frontière entre Gaza et l’Égypte pour passer en fraude les choses nécessaires pour vivre, les œufs Kinder ont toujours eu bien du mal à revenir.
J’ai vécu à cette époque des tunnels, un réseau d’artères et de veines souterraines, avec des systèmes de cordes, de leviers et de poulies qui pompaient de la nourriture, des langes, du carburant, des médicaments, des piles, des cassettes de musique, les bandes hygiéniques de maman, les crayons de Ratchel et tout ce que vous pouvez imaginer que nous parvenions à acheter dans les boutiques égyptiennes ouvertes 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Les tunnels contrecarraient les plans des Israéliens prévoyant de nous mettre au régime. De sorte qu’ils les ont bombardés et qu’un tas de gens ont été tués. Nous en avons creusé d’autres, plus gros, plus profonds et plus longs. De nouveau, ils nous ont bombardés et nous ont tué plus de gens encore. Mais les tunnels sont restés, comme un réseau vasculaire vivant. (Le Bleu entre le Ciel et la Mer – extrait)
Dans de précédentes interviews, vous avez dit que l’accueil réservé à votre livre aux États-Unis avait été bien pire que partout ailleurs. Est-ce que cela a changé, avec la publication de votre deuxième roman ?
Le titre original de mon roman était The Scar of David (La marque de David) et il avait été publié par une petite maison d’édition américaine qui a cessé ses activités. Il n’y avait pas de distribution aux États-Unis. En fin de compte, la seule raison pour laquelle il a fini par être publié par un gros éditeur américain, c’est le fait qu’il avait été traduit. Il a ainsi acquis sa propre vie : un éditeur en Italie l’a découvert, puis un éditeur français a voulu le traduire et le publier. Il s’est bien vendu ; ensuite, j’ai eu un agent à Barcelone, qui l’a vendu à Bloomsbury au Royaume-Uni, un éditeur qui a une filiale aux États-Unis. Il lui a fallu faire le tour du monde pour être publié aux États-Unis.
Même alors, aucun journal traditionnel américain n’y aurait touché. Personne ne voulait en faire la critique. Mais le livre a fini par très bien se vendre aux États-Unis grâce au bouche à oreille. Je me rappelle que mon éditeur britannique avait dit que c’était l’un de ces rares livres qui se vendent très lentement et, ensuite, atteignent une vitesse de croisière, au lieu de voir leurs ventes éclater puis retomber tout d’un coup, ce qui est plus souvent le cas avec les livres.
Quand mon deuxième roman, Le bleu entre le ciel et l’eau, est sorti, j’ai pensé : « OK, les gens ont aimé le premier. Le deuxième aura sûrement des critiques aux États-Unis. » Mais il n’y a rien eu. Pas un seul journal traditionnel n’y a touché. C’était remarquable.
Il y a par contre eu beaucoup de critiques dans les dans la presse ordinaire en France, au Royaume-Uni, en Norvège, en Suède, en Allemagne et c’est la seule façon dont j’ai pu tenir le coup, grâce aux royalties de ces pays. Mais les États-Unis ? Oubliez-les !
Vous avez également été confronté à une forte hostilité active aux États-Unis pour avoir écrit et parlé de la Palestine. Le professeur de droit de Harvard, Alan Dershowitz, s’en est pris à vous et vous a insultée lors du Boston Book Festival, voici quelques années…
En fait, ç’avait été amusant. J’ai aimé ça. Alan Dershowitz est très connu, aux États-Unis. Au tribunal et dans les débats, il harcèle littéralement ses adversaires. Cela se termine par un échange de coups de gueule, à qui crie le plus fort. Ce qui est arrivé, lors de ce débat, c’est qu’il a commencé par se montrer impossible, et je lui ai tout simplement laissé faire son numéro. C’était amusant parce que, à un moment donné, j’ai compris que si je ne l’arrêtais pas, il allait tout simplement se planter tout seul, et c’est ce qu’il a fait. Le public s’est mis à crier : « Arrêtez donc ! » Il ne cessait de m’insulter et ça n’arrêtait plus. J’avais certaines citations et des faits, et c’en est resté là.
Malgré tout cela, ce qu’il y a de bien, là-dedans, c’est que mon livre poursuit toujours son bonhomme de chemin, de lui-même, grâce au bouche à oreille et grâce aux lecteurs des autres pays.
Cela va bien au-delà de mon livre – il y a tout un mouvement d’art et de culture de la Palestine, et de militantisme politique, en particulier le mouvement BDS, qui touche la société civile. Ils vont bien au-delà des gardiens traditionnels de la connaissance, du monde de l’édition, du journalisme. L’émergence de médias indépendants comme The Electronic Intifada et Counterpunch est une grande chose.
Tout ce paysage du journalisme citoyen, de médias sociaux, de journalisme indépendant, discrédite les médias traditionnels de nombreuses façons et jette des ombres dessus. C’est réellement là où, je pense, le pouvoir palestinien peut émerger.
C’est l’espace qui m’intéresse le plus ; je n’essaie pas vraiment de frapper via les médias traditionnels. J’ai l’impression qu’ils ne méritent pas cet effort et, en fin de compte, ils se discréditeront tout simplement eux-mêmes, de la façon dont ils recourent à ce genre d’auto-censure.
Pouvez-vous nous parler de votre association avec le mouvement BDS pour la Palestine ?
Le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions a été lancé en 2005 par la société civile palestinienne, et il existe également un boycott culturel. Il est profondément enraciné dans la résistance non violente palestinienne qui recouvre toute notre histoire. Il est spécifiquement modelé sur le mouvement anti-apartheid. Il est censé engager la société civile mondiale dans la solidarité – afin d’isoler la tyrannie de l’État colonial d’implantation qui a l’intention de détruire une société indigène et qui revendique tout ce que cette société possède, y compris ses ressources, ses terres et son histoire.
Le but du mouvement est de pousser les citoyens ordinaires du monde entier à se lancer dans une lutte, à contourner les pouvoirs des chefs d’État qui opèrent manifestement sur base de la politique, du capitalisme et du maintien à tout prix du pouvoir, et non pas sur base de la morale ou de l’éthique, ni sur base de la dignité et des droits de l’homme pour tous.
Voilà, selon moi, la différence entre le pouvoir exercé par l’État et le pouvoir exercé par la société civile. Le pouvoir dirigeant opère rarement sur base des droits de l’homme, de la dignité humaine et de la justice.
Vous êtes également engagée dans un procès contre les gens qui tirent profit des colonies en Cisjordanie. Pouvez-vous nous en parler ?
Chaque année, des milliards de dollars de donations privées vont à Israël et ils sont acheminés par le biais de ces organisations exemptées d’impôt. Ces organisations sont censées être des associations caritatives et, en réalité, leur argent sert à financer des crimes de guerre. On devrait donc les dissoudre. À tout le moins, elles ne devraient pas être exemptées d’impôt. Nous nous attaquons au Trésor américain et aux individus de chair et d’os qui envoient ces milliards de dollars en Israël afin de détruire nos vies.
Il y a eu une histoire de solidarité entre la Palestine et l’Inde, bien qu’elle ait été compliquée par les transactions menées avec Israël par divers gouvernements indiens successifs. Aujourd’hui, que ressentez-vous à propos de l’amitié croissante du gouvernement indien à l’égard d’Israël, amitié qui comprend la signature de marchés portant sur des armes ?
Oui, c’est démoralisant à voir, étant donné, comme vous l’avez dit, cette longue histoire de solidarité mutuelle. Elle se manifeste à des niveaux modestes dont vous n’avez peut-être même pas conscience. Mon amie Suad Amiry, qui participait à ce festival, a eu tellement de mal à obtenir un visa indien avec son passeport palestinien. On lui a dit explicitement qu’on ne donnait pas de visas pour l’Inde à des Palestiniens.
Ce n’est pas qu’un marché portant sur des armes. Apparemment, il y a d’autres détails et d’autres niveaux de coopération qui concernent d’autres parties de la bureaucratie et de la politique de l’Inde. Cela donne l’impression d’être un réalignement des loyautés. Le régime de Modi est manifestement de droite et Israël est une nation coloniale d’implantation et, partant, de droite aussi. C’est décourageant. Je pense qu’il y a une chose qui complique la question : c’est qu’Israël est parvenu à modifier son discours de manière à ce que ça ait l’air d’un conflit religieux, tout en jouant sur l’antipathie à l’égard du Pakistan qui s’est développée en Inde après la Partition.
C’est très compliqué, nuancé et conscient. Je pense que ce doit l’être pour un discours qui est si important. Je pense que le langage que nous utilisons et l’histoire que nous racontons sont réellement ce qui modèle les attitudes des gens; c’est ce qui donne forme à l’activisme, c’est aussi ce qui donne forme à la politique.
Mais je ne pense pas que cette attitude s’étend nécessairement aux gens que j’ai rencontrés là-bas. Soit, ils se limitent à la scène culturelle et artistique indienne et je ne puis donc avoir une impression très valable de ce qu’est l’opinion publique générale à l’égard de la Palestine.
C’est à Nazmiyeh qu’il incombait de protéger Mariam de l’œuvre destructrice du hassad (le mauvais œil). Certaines personnes avaient précisément des yeux brûlants, cupides qui pouvaient facilement lancer une malédiction, même sans en avoir l’intention. Ainsi donc, Nazmiyeh insista pour que Mariam porte une amulette bleue afin de se protéger de l’envie ressentie par les personnes à l’égard de ses yeux uniques et, régulièrement, Nazmiyeh lui lut des sourates du Coran pour la protéger davantage.
Un jour, le sujet des yeux de Mariam fut évoqué par les amies de Nazmiyeh, alors qu’elles lavaient des vêtements à la rivière. La plupart s’étaient mariées récemment ou attendaient leur premier enfant mais certaines, mais d’autres, comme Nazmiyeh, étaient toujours célibataires.
« Comment peut-elle n’avoir qu’un seul œil vert ? », se demandait-on.
Nazmiyeh ôta brusquement son foulard, libérant une tête de méduse aux boucles teintes au henné ; elle fit claquer la chemise blanche de son frère dans le bac à lessive et dit avec ironie :
« L’un ou l’autre étalon romain a probablement introduit sa queue dans la lignée de nos ancêtres il y a quelques centaines d’années et maintenant elle ressort par l’œil de ma pauvre sœur. »
Dans l’intime liberté féminine de ces matinées de lessive, elles rirent toutes, les bras plongés dans les bacs à lessive, et une autre jeune femme dit :
« C’est vraiment dommage : Si ç’avait été un serpent à deux têtes, elle aurait pu avoir deux yeux verts. » (Le Bleu entre le Ciel et la Mer – extrait)
En tant qu’écrivaine palestinienne de la diaspora, vous avez parlé de la tristesse de n’être pas capable d’écrire en arabe.
Si je pouvais écrire de façon recherchée en arabe, ce serait la langue que je choisirais. Je n’écris pas pour un public américain ou pour un public anglophone même si je sais que c’est un public important pour moi. Nous ne reconnaissons pas cela comme une narration sioniste : une des choses qu’ils ont faites, en nous séparant géographiquement, c’est qu’ils nous ont séparés psychologiquement.
Ainsi donc, ce qui se passe, c’est qu’il y a cette hiérarchie de Palestiniens : qui est plus palestinien que l’autre, avec ceux de la diaspora qui sont de plus en plus distants, et particulièrement ceux d’entre nous à qui on a volé la langue arabe, en quelque sorte. Je lis et l’écris l’arabe et je parle arabe couramment, mais je ne suis pas assez perfectionnée en arabe. Je ne puis ce qui est dans mon cœur avec la langue, en arabe ? Et telle est la condition de l’exil, mais c’est également une situation très palestinienne, parce que, de nos jours, une partie de l’expérience palestinienne consiste en l’exil.
Que nous aimions cela ou pas, l’anglais et le français, l’italien, l’allemand et l’hindi, ces langues qui font désormais partie de noue, sont palestiniennes aussi. Elles sont devenues parties intégrantes de nos récits et de l’expérience palestinienne.
Vos écrits en anglais sont apparus comme une puissance contre-narration du discours israélien en littérature et dans les autres arts.
Comme vous le dites, la traduction a joué un rôle énorme, dans vos écrits, et vos deux romans ont été très largement traduits. En tant qu’écrivaine, quelle est votre relation avec ces traductions ?
Je n’ai aucune idée de ce à quoi ressemblent les traductions, sauf en arabe. Je pense qu’il est inévitable que des choses se perdent, dans une traduction. Je pense que c’est particulièrement vrai pour quelqu’un comme moi, parce que j’écris autant pour la prose elle-même que pour tout le reste. L’utilisation de la langue est aussi importante pour moi que l’histoire même. Je pense plus à la langue qu’à tout le reste. Elle commande à nos pensées, elle est en quelque sorte la monnaie que nous utilisons pour nos sentiments, mais elle est également très limitée.
Je ne pense pas que le langage s’étend à la totalité de l’expérience humaine. Nous ne le savons même pas, peut-être parce que nous avons des mots pour un tas de choses. Nous fourrons dans le même mot erroné un tas de choses dont nous faisons l’expérience. L’exemple que j’ai donné lors d’un entretien, l’autre jour, est l’expérience de l’amour. En arabe, il y a six ou huit mots pour « amour » et, pourtant, c’est encore si limité, quand on considère l’énormité et le caractère illimité de ce que nous appelons l’amour.
Les différentes expériences de l’amour que nous avons comprimées dans ce tout petit mot, c’est quelque chose d’incompréhensible, pour moi, et je pense donc qu’une partie de mon défi – et c’est un merveilleux défi – consiste à exister dans une expérience humaine dont je sais qu’elle ne peut être exprimée par des mots.
Cette expérience s’exprime par un mot inadéquat ou par des descriptions inappropriées. J’essaie en quelque sorte de peupler cela par les mots limités dont nous disposons et je les dispose sur une page. En agissant ainsi, l’utilisation de la langue et des mots est absolument primordiale et, dès l’instant où vous traduisez, je ne sais ce qui a été perdu.
C’est pourquoi j’estime que la traduction est un art, et non une simple technique. J’ai tant de respect pour les traducteurs, particulièrement ceux qui s’arrangent pour saisir l’esprit et toutes ces choses non dites, vous savez, la pâte, la matière sombre qui entoure les mots.
La première traduction en arabe que j’ai vue, en fait, je l’ai renvoyée en disant : « Non, absolument pas. Je ne signerais jamais ce texte. » C’est une traduction littérale et elle est exacte, vous savez, les mots utilisés sont exacts. Mais c’est une narration différente, ce n’est pas mon livre, ce ne sont pas les personnages, ce n’est rien. Et c’est étonnant, la façon dont cela se produit.
Publié le 23 mars 2016 sur Scroll.in
Traduction : Jean-Marie Flémal
Susan Abulhawa : « J’estime que la traduction est un art, et non une simple technique. J’ai tant de respect pour les traducteurs, particulièrement ceux qui s’arrangent pour saisir l’esprit et toutes ces choses non dites, vous savez, la pâte, la matière sombre qui entoure les mots. »
Susan Abulhawa est une femme de lettres palestinienne et activiste palestinienne, auteur du roman et best-seller international, Les matins de Jénine (Buchet/Chastel 2008).
En 2012, elle publia un recueil de poésie : « My voice sought the wind ».