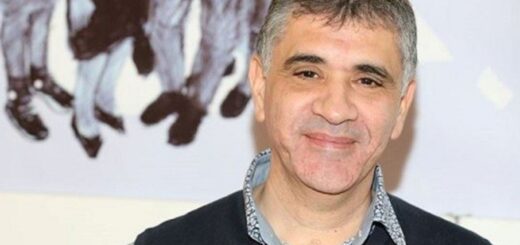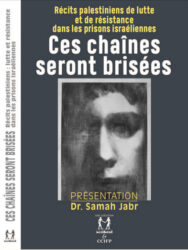Sommes-nous vraiment tous des Palestiniens ?
Sommes-nous vraiment « tous des Palestiniens », comme nous le scandons dans les rues de New York et de Londres ? Si cela est vrai, le cri de ralliement doit laisser de côté les métaphores et se manifester matériellement sous forme de résistance et de rejet. Parce qu’il ne se peut que Gaza assume seule le sacrifice.

13 janvier 2024. Au moins 400 000 manifestants propalestiniens défilent dans les rues de Washington DC en une marche nationale de soutien aux Palestiniens et d’appel au cessez-le-feu et à la fin du génocide à Gaza. (Photo : Eman Mohammed)
Mohammed El-Kurd, 13 mars 2024
Ils lui ont mis le grappin dessus à l’aéroport et ça, m’a dit mon ami, ç’a été le côté positif. Il savait qu’ils venaient pour lui, mais il était terrifié à l’idée qu’ils auraient pu faire irruption dans sa chambre à coucher et l’en extraire de force, ce qui est plus traumatisant que d’être arrêté durant une opération de routine, même si l’on doit s’attendre à être humilié et interrogé, dès qu’on atterrit à Tel-Aviv.
Omar va se retrouver derrière les barreaux, en détention administrative, pour les quatre prochains mois. Techniquement, je devrais écrire « pour les quatre prochains mois au moins », parce que l’ordonnance d’incarcération est renouvelable à l’infini, mais je ne puis supporter l’idée de cette possibilité déchirante, et encore moins imaginer ce qu’ils peuvent lui avoir fait subir, ou lui font encore subir en ce moment.
« Nous ne pouvons rien faire », ont dit d’autres amis quand j’ai suggéré de lancer une campagne en faveur de sa libération. Quand on se mue en détenu administratif – c’est-à-dire gardé en otage sans accusation ni procès – aucun niveau de pression publique ne peut influencer le commandant militaire au point de le faire revenir sur sa décision. « Pas même La Haye. »
En outre, il aurait méprisé le concept d’affiches, de protestations et de messages sur les médias sociaux uniquement consacrés à sa personne, puisque tout simplement il déteste l’individualisation inévitable de ce genre de campagnes. N’empêche que, sur le plan des qualifications nécessaires pour séduire un public occidental et le faire pencher pour la solidarité, il les a tous possédés : « l’histoire unique », le « CV des plus respectables », la « sainteté du personnage ».
Mais ils sont des centaines dans les geôles sionistes à affronter le même sort inconnu. De dizaines de milliers de personnes dont les vies – et pas seulement que la liberté – ont été décimées, pulvérisées au cours de ces derniers mois. La plupart d’entre eux sont restés anonymes, la plupart n’ont même pas été chantés. Les histoires individuelles, surtout si on les raconte sans faire preuve de prudence, tendant à isoler l’individu du groupe, à sanctifier l’individu tout en diabolisant le groupe. Les histoires individuelles tendent à situer en dehors de la politique les atrocités commises par des hommes, et ce, en les réinventant tels des désastres naturels inexplicables.
Omar a été emprisonné précisément parce qu’il refusait ce genre d’individualisation.
Puisque ce dont il est accusé n’a pas été révélé, en fonction des protocoles de la prison, je peux présumer que c’est sa présence résolue dans la rue, lors de protestations et de soutien aux prisonniers, qui l’a placé dans le champ de vision de l’ennemi.
Quand Ramallah dormait – ou était drogué, ou anesthésié au point de connaître une paralysie politique – il faisait partie des quelques centaines de personnes à être éveillées dans la cité assoupie, à scander, à donner de la voix, à envoyer désespérément des signaux de fumée, à dire à Gaza : « Tu n’es pas seule. » La géographie mutilée de notre terre n’a pu le séparer (ni ceux qui l’accompagnaient, ni ceux qu’il accompagnait) du reste de notre peuple, ses yeux voyaient Gaza, ne cessant de le faire que pour fixer du regard ceux qui détournaient le leur.
Il aurait refusé de se dissocier de ceux qui survivaient avec des aliments pour animaux ou qui recousaient les membres de leurs êtres chers sur leurs corps dérobés ; son arrestation n’est qu’un symptôme d’une situation bien plus menaçante. Cela aussi a été un point positif. Croire cela, digérer cette clarté morale et politique est plus facile pour l’estomac que de céder à sa propre impuissance ou, pire, à sa propre veulerie sordide.
*****
Il y a quelques années, dans les rues de Ramallah, quand la ville était vivante et animée, j’y étais allé d’une plaisanterie morbide. Nizar Banat, un dirigeant politique dissident d’un genre ou l’autre, venait d’être tué par une unité spéciale de l’Autorité palestinienne (qui avait obtenu la permission de sortir de la « Zone A » de Ramallah pour entrer en « Zone C » à Hébron, où habitait Banat, afin de l’assassiner), et des milliers de personnes protestaient.
« Hausse, hausse, hausse la voix », scandions-nous, « ceux qui se font entendre ne meurent pas ! » « L’ironie », dis-je en me tournant vers mon amie, « c’est qu’il est mort parce qu’il faisait entendre sa voix. » Je ne sais que faire avec la brutalité, hormis d’en rire. Cela n’avait pas faire rire mon amie.
Nizar est mort parce qu’il était seul, m’avait-elle réprimandé.
(D’une certaine façon, c’était une vulgaire allusion à quelques vers d’Amal Dunqul : « Je suis accroché à la potence matinale / et mon front est courbé par la mort / pour ne pas l’avoir courbé quand j’étais vivant. » Dunqul croyait apparemment que le bourreau n’épargnait que ceux qui se cachaient la tête dans le sable.)
« Ils ne peuvent nous tuer tous », disait-elle. Si tout le monde – avocats, médecins, épiciers, petits commerçants, professeurs, gardiens, vendeurs de voitures, vendeurs de came – faisait entendre sa voix, veut le raisonnement, rien ne pourrait nous tuer, ni les gaz lacrymogènes de fabrication américaine que nous jettent les forces de sécurité de l’AP, ni les balles, américaines elles aussi, que nous tirent les soldats qui arborent l’étoile de David sur leurs uniformes.
Quant à savoir si c’est vrai – que « le peuple uni ne sera jamais vaincu » – cela reste encore à prouver. Ce qui est vrai, de façon troublante et sans le moindre doute, c’est que notre petit problème ne concerne ni la victoire ni la défaite, mais plutôt le simple fait que nous n’avons pas d’excuse si nous nous terrons dans un silence protecteur pendant que nos frères et sœurs se font massacrer.
N’est-elle pas amère et honteuse la survie gagnée dans la seule solitude ?
*****
Sommes-nous vraiment tous des Palestiniens, les milliers et les millions que nous sommes, comme nous le scandons dans les rues de New York et de Londres ?
Moi-même, je me suis posé cette question, à tout moment, de façon obsessionnelle. Il y a deux ans, j’aurais dit, et même déclaré, que le ciment des barrières militaires israéliennes n’était rien de plus que cela – du ciment – et que le seul poids qu’il représentait était symbolique. Leurs frontières coloniales, quoi qu’ils fassent, ne peuvent ni ne pourraient rompre les liens sociaux et nationaux qui maintiennent la cohésion entre nos villes isolées. Nos différents papiers – documents de voyage, passeports, laissez-passer, ou leur absence – sont de simples mots sur une page et sont incapables de nous diviser.
Les personnes confinées en raison d’un siège ou d’une incarcération, aurais-je dit, peuvent toujours être émancipées dans leur esprit et celles qui sont dispersées derrière des murs et du fil barbelé peuvent toujours s’unir dans leurs cœurs.
Pourtant, je me retrouve dans les rues de New York et de Londres, en train de protester – il y a de la répression, mais pas encore de gaz lacrymogène – et Omar est dans une cellule de l’une des prisons de l’occupation (dans lesquelles au moins 35 prisonniers politiques palestiniens sont devenus des martyrs depuis le 7 octobre). À Gaza, des hommes en survêtement sont abattus d’une balle dans la poitrine, dans la tête, dans le courage de leur dernière action, que ce soit en courant vers un Merkava blindé ou en s’enfuyant vers une sécurité relative.
Au camp de réfugiés de Chatila, à Beyrouth, un grand-père vit et meurt hanté par la vision de sa vieille maison près du littoral, une vision si viscérale qu’il peut quasiment la respirer. À Jérusalem, je m’inquiète au sujet de la maison de ma famille, de mon frère pendant qu’il se rend au travail, de la police qui a la gâchette facile.
D’autres villes pourraient tout aussi bien être d’autres planètes, chacune avec sa principale cause de décès : ici les tireurs embusqués, là les avions de combat, ou encore les expulsions, l’exil, l’oblitération, le génocide, l’infanticide, l’humiliation, le chagrin, la bureaucratie, l’emprisonnement, la violence au sein même de la communauté, le vol, la soif, la famine, la pauvreté, l’isolement, le défaitisme, le chantage ou tout ce que vous voulez.
La fragmentation n’est pas seulement symbolique, elle nous a transformés en un million de personnes qui vivent dans un million d’États en même temps. Un segment de notre société, ce qu’il en subsiste, de toute façon, a payé un prix plus élevé, plus sanglant que le reste au cours des dernières années – et c’est un détail qu’on ne peut nullement passer sous silence.
Autrefois, je pouvais facilement me distancier des classes que je méprisais et enviais depuis longtemps (les élites, la bourgeoisie et les personnes pour qui la Palestine est une métaphore esthétique), mais une classe nouvelle a fait son apparition dans l’enfer étroit de la bande de Gaza : les affamés et ceux qui ont été dépossédés de façon répétée, sans relâche ni pitié, et il est impossible d’être plus qu’un spectateur impuissant, impossible de faire partie de cette classe sans en porter les marques, sans se plier à un sacrifice.
Il est tentant, presque réconfortant – surtout quand je regarde la nourriture sur ma table et le toit au-dessus de ma tête – de se laisser aller à la culpabilité, mais c’est un sentiment improductif, il n’enclenche pas la moindre révolution. La culpabilité s’impose comme un creux lancinant, vous êtes intensément conscient de sa présence, mais vous continuez d’enfourner les mêmes douceurs dans votre bouche, jusqu’à ce que vos dents se gâtent, jusqu’à votre autodestruction.
Ces derniers jours, je suis hanté par un refrain plus subtil, bien que plus mortel, une prise de conscience dont je ne voulais pas : Gaza a le droit de nous abandonner, de ne jamais nous pardonner, de nous cracher au visage. Combien de guerres a-t-elle dû affronter ? Combien de martyrs a-t-elle donnés ? Combien de corps lui ont-ils été volés, arrachés à l’étreinte de leurs pères ? Et combien d’entre nous bégaient-ils quand on les interroge sur la résistance, ou désavouent-ils notre droit à résister totalement, notre besoin de résister ? Combien d’entre nous font-ils passer leur carrière avant leur famille ? Combien d’entre nous auraient-ils pu faire quelque chose, même trois fois rien, mais ne l’ont pas fait ?
*****
Depuis le 7 octobre, bien des personnages publics, dont de nombreux Palestiniens, particulièrement en Occident, ont reconsidéré – quand ils n’y ont pas renoncé – la catharsis qu’ils ont ressentie en regardant les images des « bulldozers palestiniens » défonçant des parties de la clôture israélienne qui entoure Gaza. Ils sont nombreux à regretter d’avoir célébré les parapentes qui échappaient à leur camp de concentration. (J’ai écrit « bulldozers palestiniens » parce qu’il s’agit d’une expression malaisée à concevoir.)
« Il n’était pas [encore devenu] évident que des centaines de personnes avaient été délibérément abattues et kidnappées », a écrit un artiste. Il est difficile de croire qu’on ait pu penser que les images spectaculaires du 7 octobre (s’emparer de chars de l’armée puis danser sur leur tourelle) avaient été possibles sans bain de sang. On commence à se demander si ces excuses latentes n’étaient pas des démarches commerciales calculées.
Le monde occidental, avec ses éminentes institutions culturelles et universitaires, a rejeté le soulèvement de Gaza contre son siège et a exigé que notre intelligentsia agisse en conformité avec ce rejet. On nous a ordonné de maintenir le statu quo (que nombre d’entre nous ont critiqué dans leur discours en construisant leur carrière) afin de préserver nos positions, notre accès, nos réputations de « bons » [face aux « méchants »].
La soumission à la logique coloniale qui vilifie la violence de l’opprimé et ferme les yeux sur celle de l’oppresseur est devenue le prix d’entrée. Certains l’ont payé sans hésiter, d’autres ont regimbé en le faisant.
À moins que ce phénomène soit bien plus innocent que du carriérisme malin ; peut-être sommes-nous tout simplement effrayés. La crainte nous entoure de partout. Elle a infesté les salles de rédaction et les campus ; elle a envahi nos appartements et nos lieux de culte. Elle a transformé des déclarations tonitruantes en chuchotements anonymes. Ceux d’entre nous qui sont aux côtés des « enfants des ténèbres » seront soumis au chantage et placés sur une liste noire. « Vous êtes soit avec nous, soit avec les terroristes », disent les patrons et les dirigeants mondiaux à ceux qui écoutent, et c’est ainsi qu’ils leur enfoncent la crainte au plus profond d’eux-mêmes.
Ces craintes constituent-elle une véritable condition psychologique, ou sont-elles la conséquence d’une politique bien menée de propagation d’une peur destinée à étouffer les masses ? Qu’est cette peur, de toute façon, comparée à la peur de mourir de faim, d’être écrasé sous un char de l’armée ou d’être le seul survivant de toute une famille, ou encore d’avoir le coeur brisé pour la millionième fois ?
Qu’est-ce que la peur, sinon du théâtre ?
Moi aussi, j’ai peur. Quand j’ai appris la nouvelle à propos d’Omar, ils ont été nombreux à me dire que je ne devais pas rentrer chez moi, sinon je me retrouverais moi aussi menotté. Mais, même depuis ma maison de verre, je puis dire avec certitude qu’il n’y a pas de place pour la peur ou le silence. Ni quand nous avons vu des chats errants dévorer nos semblables, ni quand nous avons vu le sionisme brûler leur chair – la chair de nos semblables – à maintes reprises avec un impunité inexorable et arrogante.
C’est quasi comme si le monde nous racontait une blague morbide : nous vous tuerons si vous résistez et nous vous tuerons si vous vous cachez et, si vous refusez, et si vous cédez, et nous dévorerons votre terre et avalerons vos océans et nous vous tuerons par la faim et par la soif.
Les massacres seront télévisés, diffusés en pleine lumière du jour. Nos juges les rendront légaux. Nos hommes politiques, inertes, ineptes ou complices, les financeront et, ensuite, feindront la sympathie, le cas échéant. Nos universitaires resteront les bras ballants – c’est-à-dire jusqu’au moment où la poussière retombera, ensuite, ils écriront des bouquins sur ce qui aurait dû se passer. Leurs institutions pourries nous commémoreront après notre mort.
Et les vautours, même ceux venus de chez nous, feront le tour des musées pour glorifier et romantiser ce que naguère ils avaient condamné, ce qu’ils n’avaient pas daigné défendre – notre résistance – le mystifier, le dépolitiser, le commercialiser. Les vautours tireront des sculptures de notre chair. La plaisanterie est morbide, mais elle ne me fait pas rire.
*****
Ainsi donc, nous voici à l’heure finale, s’il en fut jamais une. La tâche est difficile, ou difficile à définir. Et je ne prêche pas depuis une chaire, mais parle tout en suffoquant sous le poids de ma propre impuissance, essayant désespérément de comprendre ce que je devrais faire.
J’entends la phrase nous devons honorer nos martyrs, mais à quoi cela ressemble-t-il de les honorer réellement ? Y assister, quoique cela puisse signifier, ne suffit pas, du moins pas en soi. Il ne suffit pas non plus de les honorer à l’aide de berceuses bavardes et des slogans creux, faussement radicaux.
Le cri de ralliement, nous sommes tous des Palestiniens, doit abandonner la métaphore et se manifester matériellement. Cela signifie que nous tous – Palestiniens ou autres – devons incarner la condition palestinienne, la condition de la résistance et du refus, dans les existences que nous menons et dans la compagnie que nous gardons. Cela signifie que nous rejetions notre complicité dans ce bain de sang et notre inertie quand nous sommes confrontés à tout ce sang. Parce que Gaza ne peut assumer seule le sacrifice.
Mais la tâche est difficile. Pouvons-nous vaincre le sionisme et venir à bout de son règne monstrueux ? Il est même plus difficile de définir ceci : la fragmentation signifie que l’on requiert de nous différentes choses dans des endroits différents. Nous affrontons des défis et des circonstances disparates. Pouvons-nous inverser les effets de la fragmentation ? La lutte collective semble impossible dans un monde hyper-capitaliste, hyper-surveillé. Une logique sans scrupule nous dit que la discipline politique est une arme inefficiente. Et les sacrifices personnels (quitter un emploi, s’immoler, et les milliers de choses entre les deux) peuvent avoir l’air futile, parce qu’ils écrasent leur auteur tout en laissant à peine une trace dans le statu quo.
Mais, une fois encore, il n’est pas question de leur statu quo, mais du nôtre. Il s’agit de notre relation avec nous-mêmes et nos communautés. Les quelques moments de réflexion avant de s’endormir, la brève rencontre avec le miroir le matin, quand nous nous demandons : Quels sont les prétextes qui nous dispensent de participer à l’histoire ?
Nous voilà donc, sur des planètes différentes, dans des réalités différentes. Des déclarations qui incluent les mots « devrait » ou « doit » courent le risque d’être désobligeantes et de manquer de vision. Pourtant, je ne puis m’empêcher de penser que ce moment conséquent nous appelle à relever le plafond de ce qui est admissible et exige de nous que nous renouvelions notre engagement envers la vérité, notre engagement à cracher la vérité, sans rechigner, résolument (et intelligemment), qu’importe la salle de conférence où nous nous trouvons et le public que nous avons en face de nous. Parce que Gaza ne peut combattre l’empire à elle seule. Ou, pour recourir à un proverbe plein d’amertume que ma grand-mère marmonnait lors des infos du soir :
« Ils ont demandé au Pharaon : ‘Qui t’a fait pharaon ?’ Et lui a répondu : ‘Personne ne m’en a empêché.’ »
******
Publié le 13 mars 2024 sur Mondoweiss
Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine.
Trouvez ICI quelques articles du même auteur ou faisant référence à lui.