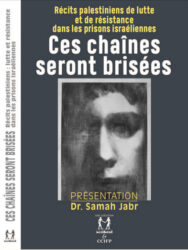Les tentes de Gaza sont devenues de véritables fours
Le survivant de l’Holocauste et intellectuel Israel Shahak a été parmi les premiers à comparer Israël aux nazis. Shahak suggérait – voici plus de quarante ans – que la seule différence était qu’Israël n’avait pas encore construit de fours ni de chambres à gaz. Au vu des conditions actuelles à Gaza, je pense qu’Israël s’y est quand même mis.

Les conditions de vie dans les tentes, à Gaza, sont épouvantables. (Photo : Omar Ashtawy / APA images)
Susan Abulhawa, le 3 mai 2024
Gaza a souvent été décrit comme un camp de concentration massif, mais les conditions actuelles sont pires que ne l’implique le terme. Ce lopin de terre densément peuplé est devenu un cloaque d’eaux usées, d’interminables champs de décombres et d’amiante pulvérisé, de matériaux particulièrement toxiques contenus dans les explosifs et d’autres substances chimiques utilisées par l’armée, de pollution de l’eau et de l’air et de toute une saleté incontournable.
Un poison en cache un autre et le tout est respiré et expiré aussi bien par les jeunes que par les personnes âgées. Les blessures ne peuvent échapper à l’infection et ne guérissent pas.
Rien ne peut guérir.
Les arbres sont partis. Dans la majorité des terres agricoles, Israël les a détruits à l’aide de ses bulldozers.
Les animaux meurent de soif ou de faim et pourrissent là où ils tombent. Les humains aussi se décomposent là où ils tombent, abattus par les tireurs israéliens embusqués.
Gaza dépasse de loin les mots que nous utilisons généralement. « Camp de concentration » n’est pas un terme assez fort.
C’est un laboratoire macabre qui teste les limites d’une terreur imposée sans relâche à une population captive et sans défense. L’incessant bourdonnement des drones (que la population désigne communément du terme zanana, en raison de leur bourdonnement lancinant, NDT) est ponctué par des bombardements injustifiés et par les cadavres déchirés et désarticulés que l’on retire des décombres.
On rince et on recommence, jour après jour. Des taux élevés de cortisol qui ne peuvent redescendre au niveau de base ravagent l’esprit et le corps.
La nourriture est rare ou malsaine. L’eau est sale.
Des maladies pourtant éradiquées se déchaînent de nouveau. Les pieds des enfants sont nus, sales et meurtris de coupures.
Cheveux et corps n’ont plus été lavés depuis des mois. La gale, les poux.
La colère. Le désespoir profond et la dépression.
La détresse. La peur. La terreur.
Voilà à quoi ressemble le génocide pour ceux qui restent en vie.
Les récits de sumud (résilience), de courage et d’héroïsme sont tout simplement une autre forme de déshumanisation. Du genre à faire croire au monde que les Palestiniens peuvent endurer n’importe quoi, même le pire.
Ils ne le peuvent. Il y a des limites.
C’en est assez. C’en est assez depuis longtemps.
La vérité est sinistre et pénible à voir, mais elle ne devrait pas être masquée par les notions romantiques de l’une ou l’autre société angélique dotée d’une capacité illimitée de résister à ce à quoi on ne devrait jamais résister.
Les tentes sont des fours
Les tentes en nylon dans lesquelles Israël a forcé les gens à vivre sont hélas des fours.
L’insolation est la toute dernière des causes de décès. Plusieurs enfants en sont morts.
Ont également subi le même sort deux chrétiennes palestiniennes, une mère et sa fille, qui s’étaient réfugiées dans une église du nord de Gaza après qu’Israël avait bombardé et détruit leur maison.
Lara Grace Khalil al-Sayegh, dix-neuf ans, et sa mère avaient finalement obtenu la permission de se rendre en Égypte après avoir acquitté les 5 000 dollars obligatoires par personne et attendu leur tour durant de longues semaines. Elles n’avaient eu d’autre choix que de s’en aller à pied dans la chaleur torride en espérant trouver une autre terre plus hospitalière pour les accueillir.
Lara s’était effondrée le long du chemin et était morte d’une insolation.
Sa mère est toujours dans le coma.
La ramassette rouge
Les enfants de mon amie passent leurs journées à échanger leurs souvenirs et ceux de leurs parents à propos de choses qui existaient dans leur maison désormais oblitérée.
« Tu te rappelles que tu devais pousser deux fois sur le bouton de la télécommande pour qu’elle fonctionne ? »
« Tu te souviens du short rouge avec Spiderman que papa portait dans la maison ? »
Ils rient. Mais ce n’est pas vraiment rire.
Quand mon amie a balayé la cuisine et qu’elle a dû utiliser un bout de carton au lieu d’une ramassette, le plus jeune de ses enfants a dit :
« Tu te souviens de la ramassette rouge sous l’évier. (…) Tu te souviens de l’évier ? »
Mon amie sait qu’il s’agit d’expressions d’un traumatisme profond dont elle ignore comment elle doit y pénétrer – et elle n’aurait d’ailleurs pas la capacité de le faire – mais en se rendant bien compte de quoi il retourne.
Elle-même tient à peine le coup. Et elle est l’une des plus chanceuses.
Elle a un travail et un modeste revenu au sein d’une ONG internationale.
Ses gamins ont des chaussures et un jeu de vêtements de rechange, qu’elle lave à la main chaque fois qu’elle rentre chez elle, épuisée.
Des besoins douloureusement élémentaires
Les enfants posent à leurs parents des questions qui n’ont pas de réponses.
« Où pouvons-nous aller chez nous ? »
Ils posent des questions bien plus vieilles que leur âge et on se demande s’ils connaissent le sens de leurs questions.
« Où en sont les négociations sur le cessez-le-feu ? Y a-t-il déjà un accord ? »
Ces questions, c’est un enfant de quatre ans qui les pose.
Je parle avec les enfants chaque fois que j’en ai l’occasion et je leur pose souvent la même question :
« Que désirez-vous vraiment le plus au monde ? »
Sans exception, ils répondent qu’ils veulent que cessent les bombardements afin de pouvoir rentrer à la maison. J’insiste un peu dans ce sens, alors.
Que désirent-ils, après le génocide ? Rien du tout.
Une maison sûre est le summum de leurs désirs les plus profonds.
« Qu’est-ce qui vous manque le plus ? »
demandé-je stupidement.
« Mon papa »,
me dit un garçon.
Il ne peut contenir les larmes qui jaillissent d’avoir prononcé le mot « baba » et ils enfouit son visage dans mes bras. Je regrette aussitôt cette question, craignant de l’avoir traumatisé plus encore.
Je passe le reste de mon temps, ce jour-là, à une conversation privée avec lui et sa mère, écoutant tout ce qu’ils désirent, et je m’assure qu’ils disposent de suffisamment de nourriture au moins pour le mois prochain.
Je ne sais pas si je le fais pour eux ou pour apaiser ma conscience coupable.
Gaza est un endroit à questions stupides, dénuées de sens, tortueuses, douloureuses et sans réponses.
L’anéantissement de la débrouillardise
Dans le passé, en dépit des campagnes de bombardement intermittentes d’Israël, « comme pour tondre le gazon », en dépit du « régime » qu’il imposait à Gaza en vue d’amener la population au bord de la famine, en dépit des coupures d’électricité, de la cruauté du siège et des emprisonnements, les Palestiniens de Gaza trouvaient toujours bien l’un ou l’autre moyen d’exceller.
Ils créaient des universités et s’arrangeaient pour devenir le peuple le plus hautement cultivé de la région par habitant, avec un taux d’alphabétisation supérieur à 97 pour 100.
Ils montaient des affaires, imaginaient des moyens de se débrouiller malgré l’électricité sporadique, créaient d’ingénieuses entreprises de recyclage, produisaient une littérature et un art profonds et mettaient sur pied une économie locale robuste.
Israël a toujours détesté cela. Les Israéliens ont toujours détesté notre joie et notre débrouillardise.
Même maintenant que les gens tiennent encore à peine à la vie, les personnalités de la société et des médias israéliens fulminent à la vue d’enfants palestiniens qui jouent dans la mer lors d’une des journées les plus chaudes de toute l’histoire de Gaza.
Ils prétendent qu’Israël ne les frappe pas encore assez durement. Apparemment, les Israéliens ont besoin d’assister à un effaçage permanent de nos sourires et au désespoir total de nos enfants.
Jusqu’à un certain point, ils y sont parvenus.
Les gens sont profondément déprimés. Les liens sociaux et familiaux qui ont longtemps fortifié la société palestinienne, surtout à Gaza, subissent un démantèlement progressif.
Mais, pour un peuple ancien comme les Palestiniens, avec des racines bien plus vieilles que celles d’Israël, plus anciennes que le sionisme et plus anciennes que le monothéisme, ce supplice s’avérera temporaire.
Alors que les conversations se poursuivent, surtout en privé après que les larmes sont tombées, les gens restent désireux de reconstruire et ils sont bien décidés à le faire. Même ceux qui prévoient de s’en aller par souci pour leurs enfants, souhaitent revenir et reconstruire.
*****
 Susan Abulhawa est née en 1967 en Palestine, de parents réfugiés de la guerre des Six-Jours.
Susan Abulhawa est née en 1967 en Palestine, de parents réfugiés de la guerre des Six-Jours.
Élevée en partie au Koweït, en Jordanie et dans la partie occupée de Jérusalem-Est, elle vit maintenant aux États-Unis.
Susan Abulhawa est l’auteur de « Les Matins de Jénine » (édité en français chez Buchet-Chastel en 2008), qui a remporté le Best Book Award 2007 dans la catégorie Fiction historique.
Elle est commentatrice politique, activiste pour les droits humains et fondatrice d’une organisation internationale pour la défense des enfants.
Son premier recueil de poésie « My voice sought the wind » est publié en 2013 chez Just World Books.
Sa deuxième publication en français, « Le Bleu entre le ciel et la mer » (« The Blue between Sky and Water »), est édité chez Denoël, en 2016.
Son dernier roman s’appelle Against the Loveless World. Bloomsbury et est édité chez Bloomsburry, Londres, en 2024.
*****
Publié le 3 mai 2024 sur The Electronic Intifada
Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine