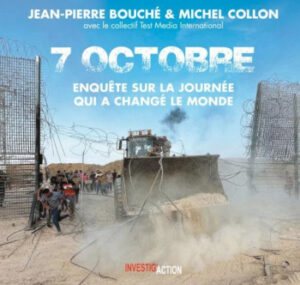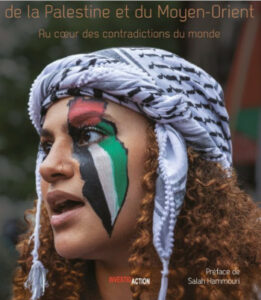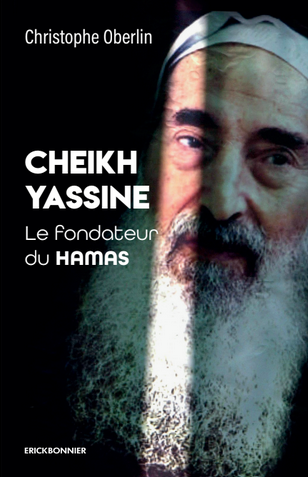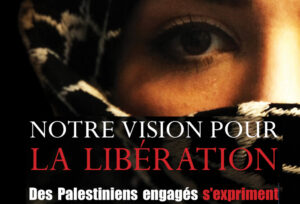Wael Jaghoub : L’expérience de la lutte à l’intérieur des prisons
Dernière minute ! (6 mai 2025) – Les forces d’occupation viennent d’arrêter à nouveau le prisonnier libéré Wael Jaghoub après avoir fait irruption chez lui, à Naplouse. Il avait été libéré d’une sentence à vie dans les geôles coloniales sionistes lors du récent échange de prisonniers Toufan al-Ahrar.
*****
L’article ci-dessous a été rédigé par Wael Jaghoub, un prisonnier palestinien libéré dans le cadre de l’échange de prisonniers Toufan al-Ahrar. L’article a été publié à l’origine en arabe, dans Al-Akhbar, pour la Journée des prisonniers palestiniens, le 17 avril 2005. Cet article a été publié sur le site de Samidoun, le 28 avril 2025.
Wael Jaghoub
Né le 23 mai 1967, Wael Jaghoub a été actif dans la lutte palestinienne dès son tout jeune âge. Lors de la grande Intifada populaire des pierres, en 1992, il a été arrêté par l’occupation et condamné à six ans d’emprisonnement dans les geôles de l’occupation. Quand a éclaté l’Intifada Al-Aqsa, il a repris son rôle d’activiste et, le 1er mai 2001, l’occupation l’arrêtait de nouveau, le soumettait à de longs interrogatoires particulièrement pénibles et, finalement, le condamnait à la prison à vie pour son rôle dans la résistance avec le Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP). Au cours de ses années de prison, al-Jaghoub a été soumis au confinement solitaire à maintes reprises, du fait que l’administration carcérale de l’occupation isole délibérément les prisonniers actifs de leurs camarades en raison de leur impact sur la réalité de la confrontation et sur la conscientisation et, du fait de cet isolement, il a été privé des visites de sa famille pendant des années.
Wael Jaghoub est considéré comme l’un des plus éminents écrivains du mouvement des prisonniers. Au cours de son emprisonnement, il a publié plusieurs livres, tout empreints de la préoccupation collective du mouvement des prisonniers comme, par exemple, « Letters in the Detention Experience », dans lequel il fait la chronique de divers stades de la lutte du mouvement des prisonniers et de ses martyrs. Parmi ses autres livres, figurent « The Organizational and Detention Experience of the Prison Branch Organization », qui couvre la période entre 2006 et 2016 avec le prisonnier Kamil Abu Hanish, et « Asira Dreams », qui a été publié en 2007.
Il a également publié des articles et des études politiques sur les prisonniers, dont cet article, datant de 2016, ainsi que plusieurs études intellectuelles, dont une étude sur la crise de la gauche palestinienne et sur les façons de s’en dégager. Depuis sa libération, il avait poursuivi ce travail, comme en témoigne l’article que nous vous proposons ci-dessous.
À sa libération, il avait déclaré :
« Je n’ai jamais perdu l’espoir, même pendant 24 heures, que la résistance me libérerait un jour (…) et je continue d’espérer que la résistance libérera ceux qui sont restés en prison. »
*****
Le Mouvement national des prisonniers palestiniens avant tout et à jamais !
L’expérience de la lutte à l’intérieur des prisons
Wael Jaghoub
Il est inévitable que l’expérience de la lutte des prisonniers palestiniens à l’intérieur des prisons sionistes – une extension naturelle de la situation palestinienne en général – doit tenir compte de la particularité de cette arène et, par conséquent, de l’importance des concepts produits par cette expérience spécifique et qui véhiculent et représentent cette dimension.
L’expérience de la lutte à l’intérieur de la prison est un engagement quotidien et direct contre le système colonial dans toutes ses composantes – politiques, sécuritaires, judiciaires et médicales. En même temps, c’est une confrontation et une défense du système moral et intellectuel représenté par l’être humain emprisonné et que le système colonial s’emploie à contrôler de façon spécifique et stéréotypée tout en le dépouillant de ses dimensions humaines et morales. L’acte de l’engagement émerge à ce niveau quand le prisonnier est confronté au geôlier et qu’il défend ces dimensions humaines et morales essentielles au point que la confrontation devient féroce, au niveau de la conscience.
Il vaut la peine de remarquer que les concepts qui dirigent la lutte ont été produits par l’expérience spécifique à l’intérieur des prisons et, en tout premier lieu, citons l’espoir – aussi bien comme valeur morale que comme principe – en s’appuyant tant sur la dimension de la volonté que sur celle de la conscience.
La conscience collective est un lien vital et central dans la lutte. Réaliser les buts des prisonniers est impossible en dehors de son cadre ou si l’on en est tenu à l’écart. Une exigence primordiale en vue de la confrontation est une direction affiliée, organisée et engagée, avec le modèle pratique de travail sur le terrain et le programme quotidien – tout cela constitue des facteurs opérant ensemble pour traduire la vision et la stratégie dans la pratique. La réalité limitée et définie à l’intérieur de la prison est régie par ces concepts et la réalité de la lutte à ce moment-là requiert qu’on tienne compte de ces concepts et qu’on les prenne très au sérieux.
L’expérience de la lutte entre le Tunnel de la liberté et le 7 octobre
Sans nul doute, le « Tunnel de la liberté » représente l’un des moments clés de l’histoire du mouvement des prisonniers et de sa longue expérience, avec ce qu’il symbolise et avec les répercussions et effets qu’il a eus au niveau national élargi, premièrement en brisant les murs d’un mythe qui avait pris racine dans les esprits des gens – que nous ne pouvons pas venir à bout de cet ennemi, pas plus que nous ne pouvons le vaincre ou concrétiser la victoire sur lui. Les victoires de toutes tailles représentent une étape importante dans toute lutte populaire : elles instillent l’espoir, renforcent la volonté et fortifient la conscience. C’est exactement ce que cet événement clé représentait en influençant également le contexte du mouvement des prisonniers et son expérience, en devenant un tournant significatif et qualitatif. Il déplaçait une fois de plus le prisonnier de sa condition de point d’attention quotidien, immédiat et personnel vers le cadre élargi de la lutte stratégique et nationale en reliant la prison à la patrie tout entière. Et, de plus, il redéfinissait correctement la relation entre prisonnier et geôlier, écartait toutes les ambiguïtés, rétablissait la présence effective du mouvement des prisonniers et restaurait la valeur de l’unité nationale en tant que véritable levier de toute confrontation, avec sa valeur, sa position et son impact.
C’était une traduction matérielle de la dimension collective de la lutte. Cela fait partie de l’impact du Tunnel de la liberté sur la réalité de lutte du mouvement des prisonniers. L’administration carcérale a estimé que le moment était opportun pour lancer une attaque contre le mouvement des prisonniers, en cherchant à le démanteler et à contrecarrer les impacts anticipés du Tunnel de la liberté sur le mouvement des prisonniers à l’intérieur ainsi que sur son engagement dans la lutte élargie de la libération nationale. Par conséquent, des mesures multiples avaient été prises : des tentatives de restreindre les conditions de vie quotidiennes, de durcir l’oppression contre les prisonniers, de supprimer des acquis et d’appliquer des mesures de restriction. Ceci émanait d’une conviction qui s’était enracinée parmi les geôliers – et qui prétendait que le mouvement des prisonniers était fragmenté et qu’il ne pourrait résister ou se confronter à ces mesures, surtout étant donné les effets de la division politique interne palestinienne sur la réalité du mouvement des prisonniers.
Toutefois, le mouvement des prisonniers possédait la lucidité nécessaire pour comprendre l’importance qu’il y avait de reconstruire la dimension de lutte de la confrontation, de s’élever au-dessus des questions banales ou mesquines et de s’engager dans une mission centrale : repousser l’agression totale et l’offensive générale lancées par l’appareil sécuritaire et politique du colonialisme sioniste.
Cela doit être perçu comme la tâche centrale et la première étape de la lutte. Cela signifie mettre de côté toutes les disputes et s’engager entièrement dans sa mission, refléter un état avancé de lucidité qui requiert une traduction dans la pratique, incarnée dans la formation d’une direction d’urgence émanant de toute l’étendue du spectre politique, former une direction effective et un corps dirigeant pour la totalité du mouvement des prisonniers, préparer un plan d’action quotidien en vue de la confrontation et de la résistance et adopter le choix de la résistance afin de repousser l’attaque. Cela s’est matérialisé via la formulation d’un programme quotidien de confrontation – via des démarches quotidiennes de protestation – qui reflétait l’unité de la volonté et de l’action et qui déstabilisait les calculs de l’administration carcérale. La préparation du lancement d’une grève de la faim a forcé l’administration carcérale à revenir sur ses mesures et démarches répressives.
L’étape qui a précédé le 7 octobre
Pendant près de deux ans s’est déroulée une période cruciale dans l’histoire et dans l’expérience du mouvement des prisonniers. Sa principale réalisation a été l’instauration d’un état d’unité nationale et l’adoption de la voie de la résistance. Cela a ouvert la voie à de nouvelles idées concernant les questions de l’emprisonnement et de sa suite, et la lutte pour la libération en même temps que ses possibilités. Cela a abouti à la proposition de la « Grève de la liberté », visant à saisir la liberté des prisonniers ou à choisir la mort, en présentant un projet et un plan à ce propos, à partir duquel plusieurs leçons et conclusions importantes ont été tirées :
Un : Faire face à l’agression ne peut réussir que par la formulation d’un état d’unité complète, basée sur les fondements de la résistance, du défi et de la confrontation. L’unité doit s’appuyer sur un programme clair et spécifique au sein d’un cadre clair et d’une vision nette.
Deux : Clarifier le but de repousser l’agression et de se concentrer sur ce qui doit être défini, sans succomber au résidu des disputes, des divisions et des positions politiques conflictuelles et, au lieu de cela, formuler un terrain commun.
Trois : La condition pour la direction de fournir la volonté d’identifier et de comprendre la situation nationale et de proposer un modèle via sa gestion de la confrontation.
Quatre : La participation collective des prisonniers réside dans la formulation de la voie unifiée, qui la soutient et qui reflète l’harmonie entre la direction et les bases populaires.
Cinq : Repousser l’agression ne peut réussir en l’absorbant mais en l’affrontant et en s’engageant contre elle en utilisant tous les outils possibles – et légitimes – au moment de la confrontation.
Six : Formuler la conscience et ses concepts changeants, y compris la compréhension du rôle et du statut de la conscience dans la lutte.
Voilà quelques conclusions d’une phase importante qui a précédé le 7 octobre, durant une période où le mouvement des prisonniers a dû affronter une attaque féroce et générale et au cours de laquelle les prisonniers ont prouvé qu’ils étaient dignes du défi.
L’étape d’après le 7 octobre
Cette date marque un autre tournant dans la forme et le niveau de l’attaque violente contre le mouvement des prisonniers. Il y a eu une transition depuis une étape de ciblage cumulatif progressif jusqu’à l’application forcée des décisions du fameux « Comité Gilad Erdan » – ainsi appelé d’après Gilad Erdan, le ministre de la Sécurité intérieure en 2017–2018, qui l’avait constitué afin d’étudier les mesures devant être prises contre les prisonniers palestiniens dans les prisons sionistes.
À l’époque, le comité avait publié un rapport comprenant plusieurs mesures, dont les principales démantelaient la présence politique des prisonniers dans la prison, ce qui signifiait la fin de l’existence des organisations et de la représentation collective des prisonniers, le ciblage des programmes culturels et universitaires et le retrait de tous les acquis du mouvement des prisonniers concernant les conditions de vie quotidienne. Ces objectifs, ainsi que les plans en vue de les appliquer, avaient déjà été préparés par l’administration carcérale. Après le 7 octobre, ils sont passés au stade d’une guerre totale contre le mouvement des prisonniers en lançant une attaque sauvage reposant sur un ensemble de mesures et de procédures que l’on peut résumer comme suit :
Un : La politique de dissuasion
L’une des composantes de la doctrine sécuritaire israélienne a été mise en pratique contre les prisonniers avant même le 7 octobre, mais son intensité a considérablement augmenté par la suite. Elle a fini par faire partie du cadre de la guerre totale contre les prisonniers et s’est manifestée via le recours à une violence explosive et sévère à leur égard – des agressions physiques quotidiennes à l’intérieur des prisons, sans distinction entre les prisonniers hommes et femmes, ou entre les enfants et les personnes plus âgées.
Ces violations ont provoqué des milliers de blessures parmi les prisonniers, et même la perte de vie, pour certains, tel le prisonnier Thaer Abu Assab, devenu martyr dans le Néguev après avoir été sauvagement battu à maintes reprises. En outre, il y avait des perquisitions continuelles, jour et nuit, dans les cellules et sections des prisonniers, ce qui maintenait un état permanent de crainte et de tension extrême, de transferts continuels, et la confiscation de toutes les possessions, y compris les vêtements, les chaussures, les montres, les appareils électriques, les télévisions, les radios, transformant ainsi les chambres en cellules nues, vides des moindres composantes de l’existence humaine.
En outre, l’administration carcérale avait doublé ou triplé le nombre de prisonniers par cellule, en guise de forme d’abus, de harcèlement et d’intimidation.
Cette politique visait à empêcher toute tentative de résistance par les prisonniers et à briser leur esprit collectif en mettant un terme à leur existence organisationnelle, en abolissant la représentation collective et en mettant fin aux programmes culturels et d’étude quotidiens vitaux pour les prisonniers. Toutefois, l’un des principaux buts, comme l’avaient ouvertement déclaré les responsables des prisons, était la revanche. Cette composante est centrale si l’on veut analyser le comportement de cet appareil et comprendre son effet sur les prisonniers.
Deux : La politique d’affamement
Affamer les prisonniers en réduisant les quantités de nourriture d’environ 80 pour 100 par rapport aux niveaux normaux a constitué la première démarche immédiate de cette politique, suivie par la confiscation de toutes les denrées alimentaires des cellules et sections de prisonniers, forçant ainsi ces derniers à ne compter que sur les très maigres repas quotidiens qu’on leur fournissait. Il en avait résulté de sévères pertes de poids chez tous les prisonniers, visibles à l’émaciation et à la faiblesse qu’on a pu observer chez les prisonniers libérés. Une simple comparaison entre l’image d’un prisonnier avant le 7 octobre et celle du même prisonnier après montre la sévérité de ce que les prisonniers endurent, l’horreur de l’existence des prisonniers et la cruauté de la politique de famine des autorités carcérales. Les quantités de nourriture fournies à une section qui hébergeait 90 prisonniers avaient été considérablement réduites, même si désormais la section comptait environ 250 prisonniers. De plus, la nourriture servie était de piètre qualité, manquait de sel, d’épices ou d’huile et, souvent, elle n’était pas assez cuite.
Le but de la politique d’affamement était de détruire et le moral et le corps du prisonnier, limitant toute capacité de résilience ou de résistance et essayant de réduire la pensée des prisonniers à de simples instincts de survie – ce qu’on pourrait définir comme une « conscientisation de la faim ». De cette façon, la faim gouverne le comportement du prisonnier et restreint sa conscience à un instinct de survie. Cela fait partie de l’agression vengeresse de l’administration carcérale à l’égard des prisonniers.
Trois : La politique d’isolement
Cette politique a été appliquée via plusieurs mesures, dont la suspension des visites de la Croix-Rouge aux prisons, la fin des visites familiales, la restriction sévère des visites des avocats et la confiscation des téléviseurs, radios et de tous les moyens de communication, isolant totalement les prisonniers du monde extérieur. Le but était de détruire le moral des prisonniers et de les pousser à abandonner les options de résistance, en faisant des agents carcéraux la seule source d’information – dont la majeure partie consistait en une désinformation destinée à induire en erreur et à semer la confusion et la tension parmi les prisonniers. Ce fut l’une des mesures les plus dangereuses utilisées.
Quatre : La politique d’homicide médical
La précédente politique de négligence médicale délibérée a été remplacée par une politique d’homicide médical délibéré, en supprimant la majorité des médicaments fournis aux prisonniers et en mettant fin aux suivis médicaux sérieux qui existaient avant le 7 octobre. Cela a abouti à la propagation de maladies de la peau – la plus fréquente étant la gale – ainsi que d’affections respiratoires, provoquant le martyre d’un certain nombre de prisonniers. Les chiffres disponibles indiquent qu’environ 69 prisonniers ont perdu la vie jusqu’à présent en raison de ces mesures.
Cette politique est la plus dangereuse, car elle vise à infliger des maladies chroniques aux prisonniers, lesquelles débouchent sur la mort. L’application de ces pratiques constitue un crime de guerre permanent à l’intérieur des prisons et il est soutenu et prôné par les instances politiques, judiciaires et sécuritaires en Israël et cela se poursuit sans interruption aujourd’hui encore. Les témoignages des prisonniers continuent d’éclairer cette terrifiante réalité qui règne à l’intérieur des prisons et qui menace les existences des prisonniers.
Qu’est-ce qui est nécessaire d’urgence, maintenant ?
Dans ce contexte de guerre d’agression et de génocide permanents contre notre peuple partout où il se trouve – et surtout dans ces endroits, à l’intérieur des prisons mêmes, où la torture quotidienne n’a pas cessé un seul jour mais n’a cessé de s’intensifier, une question urgente réapparaît : « Que faire ? »
La réponse reste généralement confuse, au vu des formes de cette confrontation contre cette agression, également appliquée à la situation des prisonniers et au fait de la dénoncer. Il y a des efforts désorganisés et dispersés sans accumulation adéquate de réalisations, outre l’absence de planification, de définition d’objectifs, de détermination des buts de la lutte et de la façon de concrétiser ces buts. Peut-être cela est-il dû principalement à l’absence d’une stratégie nationale générale de la confrontation, particulièrement en ce qui concerne les prisonniers, s’appuyant sur la croyance qu’ils seront finalement libérés. Toutefois, cela ne nie pas les crimes qui se sont produits, ni l’importance de la lutte autour de cette cause.
Cette responsabilité nous place devant la nécessité urgente d’organiser et de planifier la lutte autour de la cause des prisonniers, en cherchant à :
-Un : Tenter de repousser la guerre déclarée et l’agression contre les prisonniers, l’affronter et exercer des pressions par tous les moyens.
-Deux : Mettre en lumière les crimes en cours, les diffuser largement et présenter le discours palestinien de façon large et organisée.
-Trois : Documenter le souvenir vivace des prisonniers concernant cette phase historique.
-Quatre : Œuvrer à élargir la base de la solidarité mondiale, amplifier la voix des prisonniers, plaider pour le bien-fondé de leur cause et mettre sur pied un mouvement palestinien sérieux.
Réaliser ces buts requiert de larges efforts collectifs, ainsi qu’une volonté générale de lutter pour la libération, et de réaliser effectivement ces buts et d’autres encore. Cela requiert d’étendre ses liens parmi les institutions, mouvements, activistes et autres forces afin de bâtir une coalition internationale efficace sous forme de mécanisme et de bloc, s’appuyant sur des objectifs clairs liés aux prisonniers, à leur liberté, aux souffrances qu’ils endurent et à leur lutte pour leur libération et pour repousser les agressions dont ils font l’objet.
Une telle coalition nécessite une initiative sérieuse en vue d’aborder plusieurs tâches au sein d’un plan d’action, tâches dont les plus importantes sont :
-Un : Lancer une campagne internationale de plus en plus intense avec la participation d’institutions et de forces aux niveaux régional et international, organiser périodiquement des événements publics massifs en faveur de la cause des prisonniers.
-Deux : S’employer à former une entité pluripartite – palestinienne, régionale et internationale – dont la tâche prioritaire serait de documenter et de répertorier toute expérience de prisonnier après le 7 octobre en tant que projet de mémoire vivante authentique, collective, basée sur la lutte, en tant que témoignage réel sur les crimes de l’occupation, lequel projet devrait être diffusé aussi largement que possible.
-Trois : Œuvrer à établir une entité, initiée par des institutions, afin de fournir un soutien et des soins aux prisonniers libérés, particulièrement à ceux qui ont souffert psychologiquement après leurs expériences de détention d’après le 7 octobre.
-Quatre : Se concentrer sur l’organisation d’efforts médiatiques sur les réseaux sociaux, lancer une campagne de photos « Avant et Après » pour chaque prisonnier et créer une exposition itinérante de photos, tant dans la réalité qu’électroniquement.
-Cinq : Travailler dans le cadre de campagnes sectorielles afin de mettre en lumière les cas des femmes prisonnières, des enfants prisonniers, des détenus administratifs, des malades et des personnes âgées en prison, en présentant chaque prisonnier.e et son histoire – car ils ne sont surtout pas de simples numéros.
Bien des tâches et des idées peuvent contribuer à repousser l’agression contre les prisonniers, mais elles requièrent de la réflexion, des efforts, de la volonté et des initiatives.
Il ne suffit pas, en ce jour, d’aborder simplement la question des prisonniers toute seule.
Nous devons plutôt considérer la Journée des prisonniers palestiniens comme une journée d’évaluation de notre rôle – ce qui est requis de nous, ce que nous pouvons faire et ce dont nous avons besoin – de sorte que la cause des prisonniers ne reste pas présente uniquement de façon saisonnière ou occasionnelle.
*****
Publié le 28 avril 2025 sur Samidoun
Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine