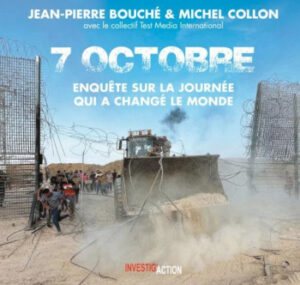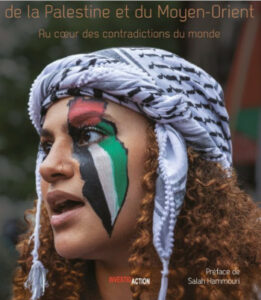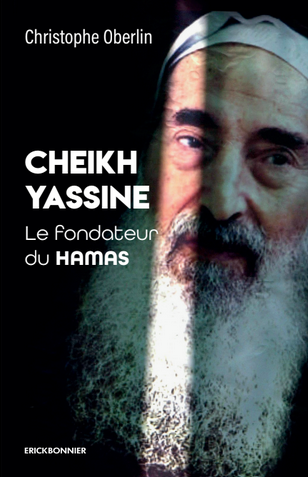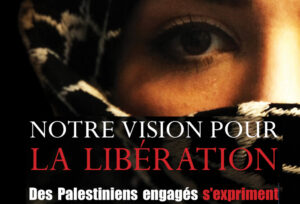Le paradoxe de la philosophie israélienne de la « victoire totale »
Aujourd’hui, avec la poursuite de la « victoire totale », Israël est passé de l’endiguement à la destruction du tissu politique et social existant de Gaza – et, si possible, comme certains responsables l’ont déclaré ouvertement, en allant en même temps vers l’oblitération de la viabilité du territoire.

Photographie de MEE montrant les importants dégâts provoqués en Israël par les frappes de représailles iraniennes après qu’Israël a attaqué Téhéran et d’autres villes, tuant ainsi des dizaines d’Iraniens. (Photo de MEE publiée le 14 juin 2025)
Rima Najjar, 28 juin 2025
Puisque ni Israël ni les EU n’ont de vision politique finale comportant une voie vers l’autodétermination ou les droits palestiniens, la libération de la Palestine dépend dès lors du point de rupture d’Israël sous la contrainte prolongée exercée par l’Iran, ses alliés (le Hezbollah, le Hamas, les Houthis) et la résistance palestinienne.
La résilience d’Israël peut être formidable, mais elle n’est pas infinie. Le coût de la poursuite d’une stratégie maximaliste qui ne propose aucun horizon politique – pas de plan pour les droits palestiniens, pas de vision de coexistence, pas d’autre objectif final que la domination militaire – dépassera bientôt le courage politique requis de la part d’Israël pour faire quelque chose de vraiment transformationnel.
Reconnaître les aspirations nationales palestiniennes, s’engager dans la diplomatie et accepter que la sécurité ne puisse être bâtie sur l’oblitération n’est pas un simple impératif moral, pour Israël – ce pourrait être d’ici peu une nécessité stratégique.
La guerre a déjà déclenché un retour de flamme régional avec l’Iran (incluant des échanges de missiles et l’implication des EU), une escalade avec le Hezbollah dans le nord et une résistance armée accrue en Cisjordanie ainsi que des attaques de la part du Yémen. Les ennemis d’Israël n’ont pas été brisés au-delà de toute possibilité de guérison et il semble que ce ne sera jamais le cas. Comme l’a dit un analyste :
« Israël n’a pas de véritable théorie de la victoire et l’Iran n’a pas été vaincu – seulement blessé et rendu furieux. »
Pas plus que ne l’ont été le Hamas, le Hezbollah et les Houthis.
Israël présume que seule la destruction complète ou la reddition sans condition d’un ennemi (étatique ou non étatique) pourra garantir sa sécurité à long terme. C’est un pari très risqué, parce qu’il échange une domination militaire à court terme contre une incertitude stratégique et une instabilité à long terme et, quoi qu’il en soit, il est irréalisable.
En poursuivant cette stratégie, Israël peut gagner des batailles, mais il perdra certainement la paix, s’aliénera ses alliés et déclenchera une guerre plus étendue. Un succès militaire sans résolution politique ne peut qu’engendrer un nouveau cycle de guerre.
L’Histoire nous montre que les victoires militaires absolues sur des forces insurgées ou mandataires sont extrêmement rares, même pour des superpuissances, parce que des combattants non étatiques n’ont pas besoin de « gagner » conventionnellement ; il leur faut simplement survivre et surpasser leur adversaire.
Voici quelques exemples :
La guerre du Vietnam (1955–1975) | EU (+ alliés) | Viet Cong et N. Vietnam | Retrait américain, victoire communiste | Guérilleros mêlés à la population, perte du soutien public pour les EU.
La guerre soviéto-afghane (1979–1989) | URSS | Moudjahidines | Retrait soviétique, plus tard reprise par les Talibans | Les insurgés bénéficiaient du soutien étranger (EU, Pakistan) et avaient l’avantage du terrain.
Les EU en Irak (2003–2011) | EU | Al-Qaeda/milices chiites | L’insurrection s’est maintenue, l’EI est apparu plus tard | L’occupation a alimenté la résistance ; pas de solution politique stable.
Israël-Hezbollah (2006) | Israël | Hezbollah | Impasse, le Hezbollah a gagné en force | Le Hezbollah s’est implanté parmi sa population qui le soutenait et s’est reconstruit avec l’aide de l’Iran.
Quant aux guerres entre États, elles peuvent se terminer par une « victoire totale », mais seulement à certaines conditions, comme l’occupation et le changement de régime (par exemple, la Seconde Guerre mondiale) ou l’effondrement total de l’ennemi (c’est-à-dire, pas de commanditaire externe).
Les fois où Israël s’est approché le plus près de la « victoire totale », ç’a été en 1967, quand il a gagné du territoire de façon décisive, et lors de sa guerre contre le Liban, en 1982. Dans ces deux scénarios, la résistance palestinienne s’est regroupée et l’expulsion de l’OLP du Liban a été le catalyseur qui a mené à la montée du Hezbollah. L’Iran n’est pas l’Irak de 2003 ; il bénéficie du soutien de la Russie et de la Chine, il nourrit des ambitions nucléaires et il est allié à plusieurs mouvements de résistance, ce qui rend impossible un changement de régime.
Israël ne peut engranger une « victoire totale » contre le Hamas à Gaza, sauf s’il réoccupe Gaza indéfiniment et, même dans ce cas, l’idéologie de la libération qui est celle du Hamas resterait enracinée, comme elle l’est depuis des décennies (la Nakba est une blessure perpétuelle, pour les Palestiniens). Une victoire militaire pour Israël ne pourrait se dégager qu’au prix d’une instabilité à long terme, d’une radicalisation et d’une condamnation internationale.
Ainsi donc, du fait qu’Israël n’a manifestement aucune finalité politique en vue pour la région, quid dans ce cas des États-Unis ?
Les accords d’Abraham de Trump ont politiquement mis de côté la question palestinienne, qui était le cœur du problème. Les accords normalisaient les relations entre Israël et plusieurs États arabes (EAU, Bahreïn, Maroc et Soudan) sans exiger de progrès sur la voie de la création d’un État palestinien. C’était une rupture avec le consensus de longue date de la Ligue arabe selon lequel la normalisation devait succéder à une résolution du conflit israélo-palestinien.
À l’origine, l’administration Trump présentait les accords comme faisant partie d’un plan plus large « De la paix à la prospérité », promettant des milliards en investissement dans les infrastructures et le développement palestiniens, mais la majeure partie de ces fonds ne se sont jamais matérialisés. Les Palestiniens ont rejeté le plan en tant que corruption économique sans droits politiques. Et, bien sûr, depuis, à Gaza, Israël a oblitéré les moindres gains économiques, avec la ruine des infrastructures et les restrictions draconiennes de l’aide.
Le plan de Trump pour Gaza implique la mise à l’écart du Hamas, l’installation d’une administration multinationale arabe et l’encouragement de l’émigration volontaire – le déplacement sous un autre nom. Il n’y a pas de feuille de route claire pour l’autodétermination palestinienne. Trump a proposé un vague soutien à la chose en tant qu’« aspiration à long terme », mais uniquement si l’Autorité palestinienne se prêtait à des réformes radicales, autrement dit, si elle acceptait des « colonies » juives qui avaient déjà dévoré la majeure partie du territoire de la Cisjordanie et si elle rejetait la volonté politique des Palestiniens.
En donnant la priorité à la normalisation avec les États arabes et en mettant de côté les revendications palestiniennes, la stratégie de Trump peut réduire les tensions entre États – mais elle a enraciné le conflit central. Comme le disait un analyste : « Vous ne pouvez bâtir la paix sur base d’une exclusion. » L’approche de Trump cimente le statu quo via lequel on gère les Palestiniens, mais sans les responsabiliser.
Et c’est là le cœur du paradoxe — et la tragédie.
Dans sa « gestion » du conflit jusqu’au 7 octobre, Israël maintenait en place un certain statu quo : il jugulait le Hamas (ou croyait le faire), il limitait la souveraineté palestinienne et évitait les négociations portant sur le statut final. Cette approche était coûteuse, mais prévisible.
Aujourd’hui, avec la poursuite de la « victoire totale », Israël est passé de l’endiguement à la destruction du tissu politique et social existant de Gaza – et, si possible, comme certains responsables l’ont déclaré ouvertement, en allant en même temps vers l’oblitération de la viabilité du territoire.
Cette escalade accroît considérablement les enjeux :
• Le coût humanitaire est ahurissant : les infrastructures de Gaza sont en ruine, la famine s’est généralisée et plus de 80 % de la population a été déplacée à plusieurs reprises. La destruction n’est pas accidentelle, elle est systémique.
• Le coût politique grimpe : la position mondiale d’Israël se détériore. Même ses alliés remettent en question sa stratégie à long terme. La CPI enquête sur ses crimes de guerre potentiels. Les EU sont sous pression afin de recalibrer leur soutien.
• Le coût stratégique s’aggrave : En détruisant non seulement le Hamas mais aussi les conditions de vie et de gouvernance des Palestiniens, Israël crée un vide qui entretient une radicalisation plus profonde, mais certainement pas la paix.
La position internationale d’Israël s’érode : les résolutions de l’ONU ont condamné ses actions, les procédures juridiques contre les responsables israéliens s’accélèrent partout dans le monde et même les alliés traditionnels d’Israël remettent en question la proportionnalité et la légalité de la campagne israélienne.
La guerre d’Israël contre la Palestine, le Liban et l’Iran est désormais la plus longue de son histoire, avec des pertes quotidiennes en vies humaines et un déplacement très répandu à l’intérieur même d’Israël. Plus elle s’éternise, plus elle met à rude épreuve le moral de la population, la préparation et l’enthousiasme de l’armée et la résilience économique.
Quand l’injustice se produit en temps réel, les discours abstraits sur les cadres et les feuilles de route peuvent sembler creux, comme une trahison de l’urgence qui se déroule sous nos yeux. Être témoin d’un génocide n’est pas seulement une expérience émotionnellement bouleversante, c’est moralement désorientant. Cela peut faire en sorte que toute discussion sur la stratégie à long terme semblera éloignée de la tragédie de la vérité viscérale sur le terrain. Mais, en donnant un sens aux événements, il est impératif, non seulement d’articuler l’indicible, mais aussi de chercher quelque lumière, même diffuse, à l’extrémité des tunnels de Gaza.
******
 Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.
Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.
*****
Publié le 28 juin 2025 sur le blog de Rima Najjar
Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine
Lisez également cet article de Rima Najjar : La Palestine et l’Iran peuvent être durement touchés et continuer d’aller de l’avant.