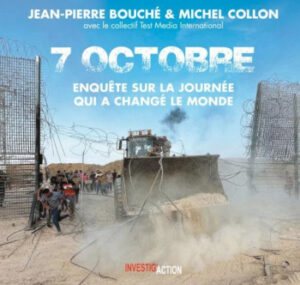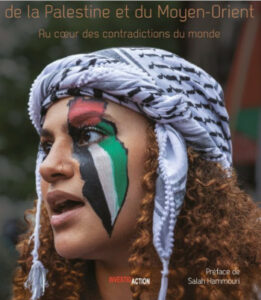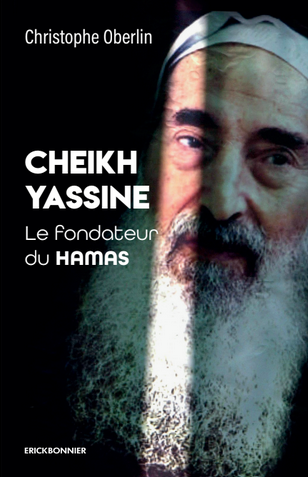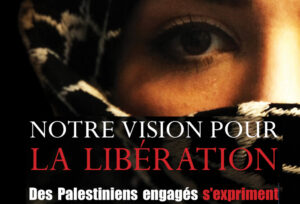Le choix difficile de l’Iran : La guerre en tant que moindre mal
Aujourd’hui, l’Iran est confronté à l’une de ses conjonctures historiques les plus complexes depuis la guerre contre l’Irak dans les années 1980. Les tensions régionales et internationales montent au fur et à mesure que les EU, l’Europe et l’entité israélienne accroissent les pressions sur Téhéran dans le cadre de leur stratégie d’ensemble visant à isoler la République islamique, à bloquer son économie, à paralyser ses capacités régionales et mondiales, le tout via des sanctions ainsi que des menaces militaires directes.

Khaled Barakat, 3 septembre 2025
« Nous disposons d’un moment pour agir de façon décisive afin de mettre un terme à l’influence iranienne dans la région. 2026 sera l’année de l’intégration d’Israël à la région. »
—Lindsey Graham, lors d’un discours à Tel-Aviv, le 29 août 2025
Les sanctions américaines et européennes contre l’Iran se multiplient de jour en jour. Les routes commerciales sont étroitement surveillées. Dans le même temps, les efforts se multiplient afin de taxer l’Iran de « menace existentielle contre la sécurité régionale et mondiale ». Cela montre que l’on est passé de la simple pression économique vers une campagne totale de ciblage politique et économique de la république.
Mais l’offensive ne s’arrête pas à Téhéran. Elle s’étend à ses alliés dans la région : pressions sur la résistance au Liban et à Gaza ; agression et siège permanents contre les parties libérées du Yémen ; et tentatives d’encerclement des partenaires de l’Iran en Irak. Washington insiste sans relâche en vue de démanteler ce qu’elle appelle le « réseau d’influence » de l’Iran et de remodeler le rapport des forces de façon à garantir la sécurité de l’entité israélienne tout en accroissant le contrôle des EU sur l’Asie occidentale. Les lignes de livraison allant de Téhéran à Beyrouth, Sanaa et Bagdad font face à une immense pression dans le même temps que les gouvernements de Beyrouth et de Bagdad sont soumis à des pressions politiques et sécuritaires visant à couper les artères logistiques et financières alimentant les alliés de l’Iran.
En Irak, spécifiquement, Téhéran est confronté à l’une des phases les plus complexes de sa guerre « non déclarée ». Washington et Tel-Aviv s’emploient ouvertement à affaiblir les Forces de mobilisation populaire (FMP), l’une des pierres angulaires de l’influence iranienne dans la région. Nées au cours du combat contre l’EI, les FPM sont devenues depuis une formidable force militaire et politique, en même temps qu’une menace directe pour la présence américaine en Irak et au-delà.
De ce fait, Washington insiste pour imposer des contraintes strictes aux mouvements des FMP et les isoler de la souveraineté irakienne, en exerçant des pressions sur Bagdad afin qu’elle limite ses capacités logistiques et militaires et qu’elle aille même jusqu’à démanteler certaines de ses brigades d’élite, sous le prétexte de « restructuration des forces sécuritaires ».
Cette trajectoire converge avec une volonté américano-européenne plus large de désarmer le Hezbollah au Liban ainsi que d’autres forces alignées sur l’Iran et œuvrant sur divers fronts. Comme elles ne sont pas parvenues à démanteler militairement la résistance au Liban et à Gaza, Washington et Tel-Aviv se tournent vers des outils politiques et économiques pour imposer la « dissuasion asymétrique » des EU face à l’influence de Téhéran. La doctrine est claire : Ce qui ne peut être réalisé par la force doit l’être en recourant à une force plus grande.
En Irak, des projets de loi cherchent à limiter les armes détenues en dehors du cadre de contrôle de l’État. Au Yémen, Ansar Allah est confronté aux pressions américaines visant à restreindre ses capacités balistiques et navales, ce qui s’inscrit dans une stratégie complète destinée à dépouiller les alliés de Téhéran d’un pouvoir de dissuasion tout en coupant régulièrement leurs lignes d’approvisionnement.
Sur le plan géopolitique, l’Iran est plus encerclé qu’en tout autre moment de l’histoire récente. Au nord, le corridor Azerbaïdjan–Arménie est devenu un champ de bataille pour Moscou, Ankara et Washington. Les EU et l’OTAN cherchent à transformer Bakou en une plate-forme de pression contre Téhéran, plus particulièrement en approfondissant la coopération militaire et les échanges de renseignements entre l’Azerbaïdjan et l’entité israélienne.
Ceci ouvre la porte à l’établissement de bases de renseignement dangereusement proches de la frontière nord de l’Iran, ce qui multiplie les menaces directes et ne manquera pas de rendre la confrontation encore plus complexe dans un proche avenir. Les inquiétudes de Téhéran à propos du Caucase sont légitimes et n’ont fait que s’intensifier après que Washington a accueilli un sommet entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, lequel a accouché d’un prétendu « accord de paix ». La pièce maîtresse était le développement du corridor de Zangezur sous le contrôle direct et la protection des EU, ce qui accorde effectivement à Washington une domination militaire et économique quasi totale.
Au niveau intérieur, l’Iran est confronté à une escalade sans précédent de la guerre des renseignements. Ces derniers mois, ses agences de sécurité ont annoncé le démantèlement de réseaux d’espionnage comptant en tout des centaines, voire des milliers d’agents liés aux renseignements israéliens et américains. Dans le même temps, l’opposition iranienne à l’étranger a été mobilisée : en armant de petits groupes de militants, en déversant d’énormes sommes d’argent dans des campagnes médiatiques en vue de saper la légitimité de la République et en œuvrant à provoquer le chaos au niveau interne.
Entre-temps, certaines voix de l’élite iranienne se disant « réalistes » émettent des déclarations confuses et hésitantes qui ne servent qu’à encourager l’agression israélienne et à affaiblir l’effort de l’Iran en vue de défendre et de fortifier le pays.
Tout cela constitue ce que l’on peut qualifier de « guerre hybride » contre l’Iran, une guerre menée en même temps de l’extérieur et de l’intérieur du pays, accompagnée d’une vaste campagne politique et médiatique en vue de recadrer le « dossier nucléaire de l’Iran » comme prétexte tout prêt à l’escalade et à l’agression. La rhétorique occidentale est devenue plus hostile encore à cause du refus de l’Iran de capituler.
Dans ce contexte, les dirigeants de l’Iran sont confrontés à des choix difficiles. D’une part, des contraintes permanentes risquent d’éroder plus encore ses capacités économiques, politiques et sécuritaires, tout en provoquant une perte progressive de son pouvoir dissuasif régional à mesure que le siège se durcit. D’autre part, la confrontation militaire est peut-être coûteuse mais, en fin de compte, elle pourrait constituer le moindre mal. En dépit de ses dangers, la guerre a le potentiel d’unifier le front domestique, de redessiner les équations de dissuasion et d’empêcher Washington et Tel-Aviv de démanteler pièce par pièce l’influence de l’Iran sur une voie qui mènerait finalement au démantèlement de l’Iran même.
Le plus grand défi de l’Iran, c’est que le temps n’est pas de son côté. La stratégie américaine de la « pression maximale » peut avoir échoué dans la réalisation de ses grands objectifs ces dernières années, mais elle a rapporté des gains tactiques à Washington et à ses alliés ; des gains qui pourraient bientôt se traduire par des menaces existentielles pour Téhéran.
Même dans ce cas, l’Axe de la résistance a fait preuve d’une patience et d’une résilience remarquables, en particulier à Gaza, à Beyrouth et à Sanaa. Entre-temps, la position israélienne a décliné tant au niveau régional qu’international. Après le 7 octobre et la guerre génocidaire contre Gaza, l’opinion populaire dans la région ainsi que dans le monde s’est déplacée de façon décisive du côté de la résistance et de l’option de la confrontation totale.
Aujourd’hui, l’entité israélienne est embourbée dans un désarroi interne et une confusion stratégique sans précédent, malgré le « surplus de pouvoir » garanti par Washington. L’image soigneusement cultivée du « pauvre petit Israël », longtemps promue par la propagande occidentale, s’est effondrée, dénonçant aux publics du monde entier la nature raciste et criminelle du projet sioniste. Viennent s’ajouter à cela l’effondrement du moral de l’armée israélienne et les conséquences stratégiques de la guerre de 12 jours contre l’Iran, qui ont révélé crûment les faiblesses qui règnent au cœur de l’appareil militaire israélien.
Le message que l’Iran pourrait transmettre au monde est celui-ci : Le prix de la guerre est élevé, mais celui de la reddition l’est bien plus encore. Dans une région qui subit des transformations rapides, Téhéran pourrait conclure que la guerre n’est pas simplement une option parmi tant d’autres, mais avant tout l’option la moins coûteuse face à un projet conçu à le saigner complètement jusqu’au moment où il n’en restera plus rien.
*****
Cet article, initialement rédigé en arabe, a été publié ensuite dans Al-Akhbar English avant d’être repris dans Masar Badil le 3 septembre 2025.
Traduction de l’anglais : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine.