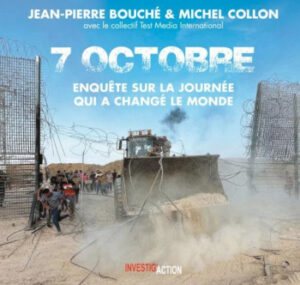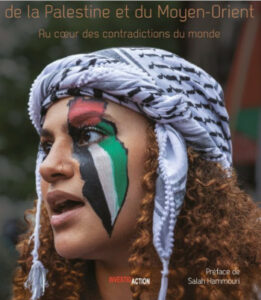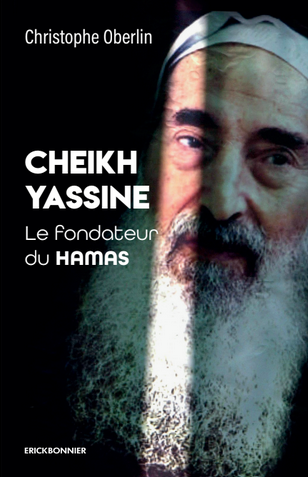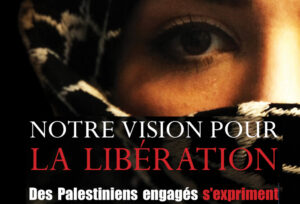Résilients et inébranlables : Tels sont les journalistes qui ont déjoué les plans israéliens
Aucun endroit au monde, à aucun moment de l’histoire, n’a assisté à des assassinats de journalistes et de travailleurs des médias en aussi grands nombres que dans la bande de Gaza durant le génocide qui a suivi le 7 octobre 2023.

Des collègues et une foule en deuil prient devant les corps des journalistes d’Al Jazeera Ismaïl al-Ghoul et Rami al-Rifi, son cameraman, tués par une frappe de drone israélien à Gaza, le 31 juillet. (Photo : Hadi Daoud / APA image
Fayed Abu Shamala, 16 février 2025
L’occupation israélienne a tué des journalistes en les bombardant, en les mitraillant, en recourant à des snipers ou en démolissant leurs maisons alors qu’ils s’y trouvaient en compagnie de leurs familles, et ce, avec une violence à laquelle le monde n’avait encore jamais assisté.
En tout, 207 journalistes et travailleurs des médias – hommes et femmes jeunes et plus âgés – ont été tués sans la moindre discrimination, à raison de trois par semaine en moyenne, soit trois fois plus que la moyenne mondiale des morts violentes de journalistes lors des pires années, particulièrement dans les zones de conflit, ou en raison de leur travail d’investigation sur le crime organisé, le trafic d’êtres humains, la corruption et autres questions.
Il n’est pas utile ici de demander à l’occupation pourquoi elle a ciblé délibérément des journalistes – la plupart du temps sinon chaque fois –, parce que, constamment, l’occupation a fabriqué des récits fallacieux à propos de la relation entre les journalistes palestiniens à Gaza et leur cause nationale, la souffrance de leur peuple et leurs liens avec les factions de la résistance.
L’accusation a également fabriqué de toutes pièces des accusations contre les personnes dont les assassinats ont déclenché des tollés mondiaux relativement importants, comme ce fut le cas avec l’assassinat du journaliste Ismaïl Al-Ghoul, un jeune journaliste prometteur qui couvrait les phases les plus dures de l’agression contre la ville de Gaza et du siège, suivi de l’invasion, de l’hôpital al-Shifa. Il avait été arrêté brièvement, puis relâché, avant que des missiles israéliens ne le frappent en ce jour médiatiquement important, précisément, où il couvrait les retombées de l’assassinat d’Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas. Les deux Ismaïl sont devenus des martyrs le même jour, presque de la même façon, l’un à Téhéran, l’autre à Gaza.
Une stratégie systématique pour agir à l’égard des médias
Depuis le 7 octobre, l’occupation israélienne empêche les journalistes étrangers d’entrer à Gaza pour deux raisons :
La première consiste à supprimer la protection dont bénéficient les journalistes à Gaza. La présence de journalistes étrangers ou de n’importe quelle équipe internationale, particulièrement occidentale – comme lors de toutes les guerres précédentes – signifie que l’occupation doit être plus précise dans ses ciblages. Cette fois, l’occupation a voulu éliminer cet obstacle majeur.
La seconde raison consiste à protéger l’occupation de la responsabilisation par les journalistes étrangers qui – quelles que soient leurs opinions politiques – décriraient et publieraient les atrocités et crimes perpétrés par l’occupation.
Les journalistes palestiniens sont parvenus à compenser cette absence en diffusant, préparant et procurant au monde des images réunissant le plus de détails possible et ils n’ont jamais hésité à se charger du fardeau que cela pouvait représenter.
Les diverses mesures qui ont été prises
En réponse, l’occupation a pris une série de mesures :
Primo : L’évacuation des journalistes des agences et institutions médiatiques étrangères, qui avaient une grande expérience, une haute expertise et de solides connexions avec le monde extérieur. À la demande de leurs pays, la plupart ont été évacués vers l’Égypte, le Qatar ou vers d’autres pays sous le prétexte de vouloir les protéger.
Secundo : La destruction des institutions et matériel médiatiques palestiniens, y compris les studios, les caméras, les véhicules de diffusion et autres.
Tertio : L’assassinat direct d’un grand nombre de journalistes travaillant avec des institutions médiatiques palestiniennes, en bombardant leurs maisons ou en les abattant alors qu’ils travaillaient, ou encore en recourant à des drones.
Quarto : La mise en doute de la crédibilité et du professionnalisme des journalistes, en créant de faux récits destinés à affaiblir leur crédibilité, ce qui facilitait leur ciblage à tout moment et de n’importe quelle façon.
Quinto : Les arrestations – journalistes et travailleurs des médias étaient fréquemment arrêtés, torturés en même temps que leurs familles étaient harcelées. Dans certains cas, leurs domiciles étaient incendiés, comme ce fut le cas avec le journaliste vétéran Imad Al-Ifranji Abu Mesab, toujours emprisonné à l’heure actuelle.
Sexto : Les blessures et le refus de traitement – ceci confirme la théorie du ciblage délibéré. S’il s’était agi d’événements simplement fortuits provoqués par la nature de la bataille, l’occupation aurait pris soin de fournir de l’assistance, comme elle le fait pour ses propres soldats blessés au combat. À tout le moins, elle leur aurait permis de recevoir des soins médicaux dans l’endroit le plus proche possible, ou de se rendre à l’étranger pour y être soignés, surtout si l’on considère que l’occupation a détruit les institutions médicales de Gaza, les laissant dans l’impossibilité d’assurer les services nécessaires.
Septimo : Les menaces via des appels téléphoniques et les programmes de la télévision israélienne, qui sont itérativement utilisés contre des dizaines de journalistes et de photographes afin de les intimider et de les amener à cesser de couvrir les événements.
Comment les journalistes palestiniens ont-ils répondu ?
Les journalistes n’ont pas succombé à ce ciblage généralisé. Au lieu de cela, ils ont poursuivi leur couverture des événements et se sont donné pour mission de trouver des alternatives et des moyens de fournir des images et des informations en direct ou enregistrées qui dénonçaient les pratiques et crimes de l’occupation dans chaque coin de Gaza. Il s’appuyaient sur les expériences transmises par trois générations de journalistes depuis la Première Intifada, connue sous le nom d’« Intifada des Pierres », en 1987.
Ils ont également puisé de la force dans leur foi en leur rôle, en l’impact qu’ils avaient et en leur capacité à protéger leur concitoyens par le biais de leur travail, comme ils l’avaient fait dans toute guerre vécue par Gaza au cours des deux décennies écoulées. Ils restaient engagés envers leurs devoirs, continuant d’assurer la couverture en faisant en sorte que l’image de Gaza ne soit jamais perdue de vue.
Des résultats sidérants
Une nouvelle génération de journalistes est apparue, portant la bannière de leurs prédécesseurs et faisant en sorte que l’histoire de Gaza soit racontée au monde sans être occultée. Ces journalistes sont bien vite devenus célèbres pour leur présence constante dans les zones de danger, leur profonde connexion avec leur communauté et le fait que leurs maisons, comme le reste de Gaza, étaient ciblées et que leurs familles elles aussi avaient été déplacées ou bombardées. Le monde a assisté à leurs cris de crainte, leur fuite en panique, il les a vus trembler de froid, mourir de faim, souffrir de leurs blessures ou tout simplement faire leurs adieux à leurs proches disparus.
C’est par le biais de ces journalistes que Gaza a été en mesure de raconter son histoire avec audace et clarté. L’occupation a été minablement incapable de faire taire la vérité et les institutions médiatiques internationales qui, naguère encore, paraissaient impressionnantes, se sont enfoncées dans la médiocrité et l’inefficacité en devenant même complices de l’occupation. Elles n’ont jamais livré combat pour les journalistes de Gaza pas plus qu’elles ne sont entrées à Gaza pour couvrir l’horrible guerre dévastatrice que nous avons fini par appeler « la guerre génocidaire ». Pas plus qu’elles ne remplissent leur devoir qui consiste à transmettre la vérité ou à défendre les droits des journalistes palestiniens à bénéficier de la protection et de la liberté stipulées par les conventions internationales.
Les journalistes de Gaza méritent d’être mondialement reconnus
Les journalistes de Gaza méritent de se voir décerner des récompenses pour leur bravoure, lors des festivals et événements internationaux. Ils ont tenu bon, ont enduré les pires difficultés et se sont accrochés à leur peuple et à leur cause. Ils ont transmis chaque image de la souffrance, dont les traces étaient évidentes sur leurs visages et leurs corps, dans leurs yeux, leurs voix, leurs possessions.
Trois générations de journalistes
Peut-être ce texte ici est-il un compte rendu personnel de la profession de journaliste à Gaza, et non une histoire scientifique précise, puisque la profession n’a pas débuté en même temps que mes propres débuts. Bien des journalistes nous ont précédés, ma génération et moi-même, au fil des années. Toutefois, j’ai remarqué que notre génération formait une couche complète de journalistes dans différents domaines, et la plupart avaient rallié le premier soulèvement populaire palestinien d’importance, connu sous le nom d’Intifada des Pierres, laquelle avait débuté en 1987.
Ils ont alors été témoins des développements politiques qui allaient suivre, particulièrement le « processus de paix », les accords d’Oslo, et l’établissement de l’Autorité palestinienne après le retour de Yasser Arafat et de l’Organisation de libération de la Palestine. Ma relation personnelle avec le journalisme a commencé avec cette génération, qui elle aussi a été ciblée par l’occupation au cours du génocide, comme on l’a vu dans l’assassinat de l’éminent journaliste Mustafa Al-Swaf, devenu martyr en même temps que plusieurs membres de sa famille.
Un autre collègue de cette époque était Wael Al-Dahdoh, le chef du bureau d’Al Jazeera qui, en même temps que sa famille et sa maison, a été ciblé. Lui-même a été blessé alors que plusieurs membres de sa famille sont devenus des martyrs.
Le vétéran du journalisme, Imad Al-Ifranji, une autre personnalité de premier plan du journalisme à Gaza, a été torturé par l’occupation après son arrestation. Sa maison a été incendiée et, de façon brutale et cruelle, sa famille a été forcée par la même occasion de chercher refuge dans le sud de Gaza.
Je n’exagérerais pas en disant que la plupart des membres des première et deuxième générations, ceux qui sont apparus dans le giron de l‘Intifada Al-Aqsa en 2000, ont connu diverses guerres successives depuis 2008. Parmi eux figurent des journalistes comme Tamer Al-Mishal, Moamen Al-Sharafi, Hisham Zaqout et d’autres, qui travaillaient dans diverses institutions médiatiques, couvrant les guerres de 2008 à 2021. Eux aussi ont été visés par des assassinats, des blessures, des menaces ou des arrestations et leurs familles et leurs domiciles ont été ciblés également.
La troisième génération de journalistes est apparue après la guerre de 2021 ou juste avant mais elle s’est vraiment démarquée quand elle a repris la flambeau avec distinction lors des batailles les plus difficiles de toutes, qui ont débuté par l’éruption du Déluge d’Al-Aqsa, fin 2023. Ils ont présenté une image honorable de leur bravoure, de leur professionnalisme, de leur loyauté nationale et ils ont porté à bout de bras la cause de leur peuple. Nous sommes fiers d’eux et nous célébrons leur travail.
Nous portons le deuil des 207 journalistes martyrs et souhaitons une entière guérison aux blessés et la liberté des prisonniers. Puisse Dieu indemniser les affligés avec les meilleures des récompenses.
L’histoire des journalistes de Gaza n’est qu’un petit exemple de tous les secteurs des Palestiniens à Gaza. Leurs expériences, les guerres et l’inspiration des générations antérieures en ont fait des êtres résilients et ils ont été forcés de porter de lourds fardeaux. Certains sont passés et d’autres attendent toujours, indéfectibles dans leur engagement.
*****
Article publié au départ sur le site d’Al-Jazeera Arabic
Traduit et présenté en anglais le 16 février 2025 sur The Palestine Chronicle
Traduction vers le français : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine