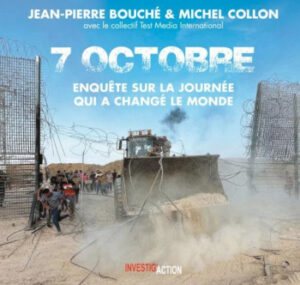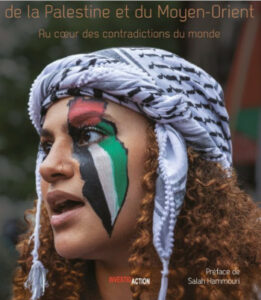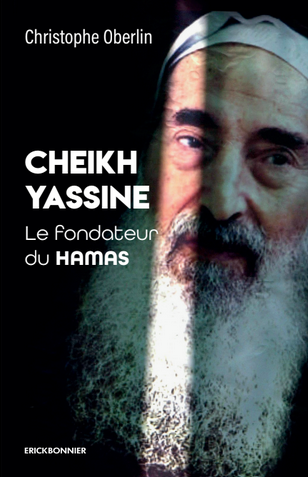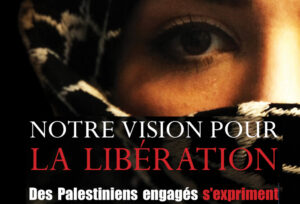La guerre où les corps des femmes ont perdu leurs droits
La guerre à Gaza n’est pas qu’une histoire de décombres et de frappes aériennes. C’est aussi l’histoire de la fille qui a ses règles en plein bombardement, la mère qui saigne en silence et qui fait une fausse couche sur un sol glacial ou qui met un enfant au monde sous des drones.

Par Mariam Khateeb, 19 mai 2025
En octobre, j’ai saigné pendant dix jours sans avoir accès à une salle de bain convenable.
À l’instar de la plupart des lieux de refuge à Gaza, aucune intimité n’était possible, dans la maison où nous nous étions abrités. Quarante personnes dormaient dans deux pièces. La salle de bain n’avait pas de porte, uniquement un rideau déchiré. Je me souviens d’avoir attendu que tout le monde soit endormi pour me laver à l’aide d’une bouteille d’eau et de quelques bouts de tissu. Je me souviens d’avoir prié afin de ne pas souiller le matelas que je partageais avec trois cousines. Je me souviens de la honte – non pas de mon corps, mais de mon incapacité à en prendre soin.
En temps de guerre, le corps perd ses droits, et plus particulièrement le corps de la femme.
Les gros titres en parlent rarement. Ils ne disent pas ce que cela signifie pour une fille d’avoir ses règles en plein bombardement, ni ne parlent des mères forcées de saigner en silence et de faire une fausse couche sur un sol glacial ou de mettre un enfant au monde sous des drones. La guerre à Gaza n’est pas qu’une histoire de décombres et de frappes aériennes. C’est une histoire de corps perturbés sans arrêt, envahis et auxquels est refusé tout repos. Pourtant, d’une façon ou d’une autre, ces corps continuent d’être.
En tant que femme palestinienne et étudiante déplacée vivant actuellement en Égypte, je porte ce souvenir corporel en moi. Non pas comme une métaphore, mais comme un fait. Mon corps sursaute encore aux bruits forts. Ma digestion est défaillante. Mon sommeil vient par fragments. Je connais bien des femmes – des amies, des proches, des voisines – qui ont développé des maladies chroniques pendant la guerre, qui ont perdu leurs règles pendant des mois, dont les seins se sont taris alors qu’elles essayaient d’allaiter dans les abris. La guerre entre dans le corps comme une maladie et elle y reste.
À Gaza, le corps est un registre des perturbations. Très tôt, il apprend à se contracter – à occuper moins d’espace, à rester en état d’alerte, à réprimer le désir, la faim, les saignements. La nature publique du déplacement détruit toute intimité alors que la crainte constante ronge le système nerveux. Des femmes qui naguère gardaient leur pudeur se changent aujourd’hui devant des étrangers. Les filles cessent de parler de leurs cycles. La dignité devient un fardeau que personne ne peut assumer.
Tel est le paradoxe de la survie : Ce même corps auquel est refusée la sécurité devient un instrument de résistance. Les femmes font bouillir des lentilles à la lueur des bougies, elles calment les enfants dans les sous-sols, elles bercent les mourants. Leurs actes n’ont rien de passif ; ils sont radicaux. Avoir ses règles, porter, nourrir, soulager – le tout en pleine destruction – c’est insister sur la vie.
Je reviens encore et toujours sur l’image de ma mère au cours de la guerre. Le dos courbé sur un pot, les mains tremblantes, les yeux examinant le plafond à chaque bruit. Elle ne mangeait jamais avant que tous les autres ne l’aient fait. Elle ne dormait jamais avant que les gosses ne dorment. Son corps portait l’architecture de la guerre en même temps que celle de la maternité. Je comprends aujourd’hui à quel point son épuisement était politique – comment son labeur, à l’instar de celui de bien des femmes palestiniennes, défiait la logique de l’anéantissement.
Il n’y a pas de tente pour le corps, à Gaza. Pas d’espace sûr où le corps de la femme peut s’épanouir sans crainte. La guerre nous met complètement à nu – nous dépouillant non seulement de nos maisons et de nos biens, mais aussi des rituels qui nous rendent humains : le bain, les menstrues, pouvoir faire son deuil en privé. Mais, même sans abri, nos corps endurent. Ils se souviennent. Ils résistent.
Et, peut-être, dans leur persistance frémissante, écrivent-ils l’histoire la plus véridique de toutes.
*****
Mariam Mohammed El Khateeb est une écrivaine palestinienne, une poétesse et une militante de Gaza. Elle fait des études en dentisterie en Égypte, où elle poursuit également ses activités littéraires. Ses écrits – publiés sur des plates-formes comme This Week in Palestine, We Are Not Numbers et Avery Review — explorent les thèmes du souvenir, de la guerre et de la résistance, surtout selon des perspectives féministes et existentielles. Elle se sert du récit comme d’une forme de résistance culturelle en traduisant par écrit l’expérience palestinienne et en amplifiant les voix de son peuple.
*****
Publié le 19 mai 2025 sur Mondoweiss
Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine