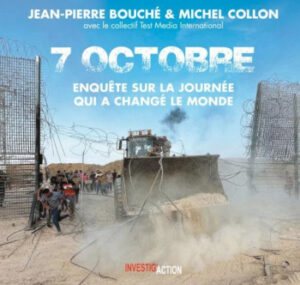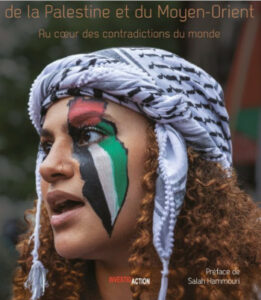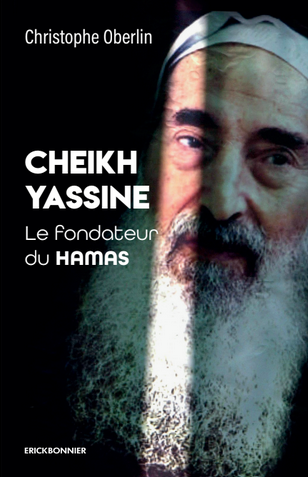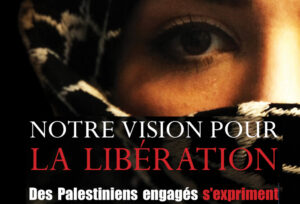Derrière l’ennemi partout : Le retour des opérations palestiniennes à l’extérieur ?
En 1971, le Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP) publiait un numéro de son journal Al-Hadaf, dont la deuxième édition était consacrée au thème « Le FPLP et les opérations à l’extérieur ». Le texte examinait la logique du Front et ses réponses aux diverses réactions soulevées par les opérations qu’il avait lancées depuis juillet 1968. Parmi ces opérations figuraient des détournements d’avions et des attentats à la bombe contre des entreprises et des ambassades israéliennes en divers endroits d’Europe.

Moussa al-Sadah, 24 mai 2025
La réponse du Front se concentrait sur ses principes fondamentaux et, en tout premier lieu, sur la nature et la définition de l’ennemi. Selon le FPLP, le camp de l’ennemi est une triade : l’entité israélienne (le mouvement sioniste), l’impérialisme mondial et les réactionnaires arabes. Ceci constituait un diagnostic précis du conflit, affirmait le Front. Par conséquent, il prétendait que le ciblage de l’ennemi ne devait pas être limité par la géographie, puisque l’ennemi lui-même avait fait du monde entier un champ de bataille.
Le deuxième pilier du raisonnement du FPLP concernait les médias et la mobilisation : Les opérations à l’extérieur, loin de ternir la cause palestinienne, étaient en fait une forme de média révolutionnaire qui forçait le monde à prêter l’oreille aux Palestiniens.
« Ces opérations », disait le pamphlet, « sont une propagande révolutionnaire qui retire la cire des oreilles européennes. »
Durant cette période, la dimension médiatique était prioritaire pour les fedayin qui accomplissaient ces missions. Dans la volonté collective et le legs des martyrs de l’opération de Munich en 1972, les combattants écrivaient :
« Nous espérons que notre action révolutionnaire va aider le monde à saisir la réalité grotesque de l’occupation sioniste de notre terre. Notre méthode révolutionnaire cherche à dévoiler les liens entre les sionistes et les impérialistes. »
Les martyrs et le Front avaient raison. Ces opérations faisaient fonction de tollés à l’encontre d’une emprise sioniste quasi totale sur les médias mondiaux. Pour les Palestiniens et les Arabes vivant sous un silence étouffant, ces missions étaient des cris incarnés dans la chair et le sang. Comme l’avait dit un jour le martyr Nizar Banat :
« Dans les années 1970, les Palestiniens frappaient fort et le monde sympathisait. Il sympathisait quand nous ripostions. »
La réalité d’aujourd’hui n’est guère éloignée de la logique exposée autrefois par le FPLP. En fait, le camp ennemi, avec ses larbins sionistes, impérialistes et arabes réactionnaires, n’a jamais été aussi assoiffé de sang. La logique médiatique elle aussi reste simple : la résistance armée est toujours la forme la plus puissante des médias révolutionnaires. Ce qui a changé, toutefois, c’est que les nouveaux outils de communication ont donné la possibilité à la lutte armée en Palestine occupée de devenir l’objectif principal. Que ceux qui croient que l’actuel changement de discours en notre faveur est dû à un réveil moral mondial face au génocide imaginent ne serait-ce qu’un instant ce qu’il adviendrait si la résistance à Gaza devait capituler, si l’armée israélienne faisait son entrée et cédait l’enclave à l’Autorité palestinienne. De quoi aurait l’air la narration, dans ce cas, particulièrement si elle était écrite par des collaborateurs de l’occupation ?
La montée du « triangle rouge » marque un changement historique : Pour la première fois, nous assistons à une admiration et un respect répandus envers la résistance armée, peut-être même plus que n’en ont reçu jadis le Viet Cong ou le FLN en Algérie. Même avec de fortes différences idéologiques parmi les partisans de la Palestine (et parmi les Palestiniens et les Arabes eux-mêmes),
« ils sont tous des triangles rouges », comme disait un ami. Ce que protègent les embuscades de la résistance est le pire cauchemar des sionistes : notre fusion unique et ininterrompue d’héroïsme et de victimisation – un paradoxe que nous exprimons sans contradiction. Dans la même veine, les opérations au Yémen sont un écho du modèle historique des « opérations extérieures ».
Si une bombe posée à la fin des années 1960 dans le bureau de la Compagnie de transport maritime ZIM à Londres symbolisait le ciblage à l’extérieur, dans ce cas, les frappes actuelles du Yémen frappent le centre nerveux de la compagnie.
Mais notre question principale et la plus pressante reste celle-ci : les changements dans la narration, qu’importe leur importance stratégique, ne font pas cesser un génocide. Alors que le Yémen a affronté avec succès les EU et a fait du tort à leurs intérêts, il n’est pas encore parvenu à forcer l’ennemi à arrêter sa campagne d’extermination. Quand on revient au manuel du FPLP, ses orientations stratégiques méritent d’être rappelées :
« Nous devons adopter le principe de l’adaptation aux conditions objectives de la bataille, à la nature de l’ennemi et à ses outils. »
De ce fait, malgré l’angoisse et la rage, imaginez que dans quelques décennies nous nous posions la question : Comment ces bâtards de sionistes nous ont-ils massacrés si systématiquement ? Comment se fait-il que nous n’avons pas été « derrière l’ennemi partout » ?
Toutefois, cette question requiert une analyse stratégique. L’une des leçons à tirer des textes du FPLP est l’importance de débattre autour de la stratégie, et c’est une chose que les mouvements de résistance ont souvent négligée à une époque infestée de fanfare et de glorification aveugle, avec des conséquences dévastatrices. Ironiquement, la même brochure mettait en garde contre la capacité de l’ennemi
« d’influencer ceux qui sont très sectaires, régionalistes ou très attirés par les gains personnels »
(faisant remarquer qu’à l’époque, le « sectarisme » renvoyait davantage au factionnalisme que ce n’est le cas actuellement).
C’est une question épineuse. On pourrait prétendre à bon escient que de telles opérations de nos jours pourraient se retourner contre nous en ravivant la propagande sioniste qui présente sa guerre comme une extension de la « guerre mondiale contre le terrorisme ». Cela pourrait également approfondir l’implication occidentale dans les efforts en vue de nous exterminer. De plus, le fantasme prétendant que les puissances occidentales interviendront pour faire cesser le génocide par souci pour leur propre stabilité interne est un scénario faiblard et improbable. Une chose n’est pas négociable, toutefois : cibler des soldats et des colons sur les terres arabes et dans la normalisation des États arabes n’est pas seulement légitime, mais attendu depuis longtemps.
Dans ce sombre chapitre de notre lutte, nous avons trois buts immédiats : faire cesser la guerre, mettre un terme à l’occupation de Gaza et lever le siège. Réaliser ces buts signifie briser l’aile droite israélienne et Netanyahou en personne. Mais, sur le plan intérieur, il n’y a pas de « division » sioniste à exploiter ; Netanyahou commande toujours une majorité solide. Sa disparition, à ce stade, serait à la fois décisif et bénéfique. Mais le véritable point de pression se situe à l’extérieur, au sein même de l’administration américaine et, spécifiquement, en la personne de Donald Trump. La question clé, dans ce cas, est : Comment forcer les Américains à mettre une laisse à leur chien enragé ?
Deux ans après le début de cette guerre, il ne nous reste guère d’outils et, en raison de mauvais calculs, nous avons mal utilisé ceux que nous possédions. Ce qui reste est la pression mondiale née de la violence génocidaire sioniste : son impact sur les discours des médias et sur l’opinion publique. Mais même cet outil a ses limites. Alors, que le génocide peut avoir attisé la répulsion mondiale envers le sionisme, il a paradoxalement instillé la peur, ce qui se traduit par de lâches retraites et des instincts de survie. L’impact de cet outil, bien que mesurable par de petits changements au sein de l’opinion publique, n’est pas fiable et est trop lent. Le temps est fait de sang et de membres d’enfants et les Américains et les sionistes ont déjà accepté le coût de mauvaises relations publiques et ils ont doublé la mise.
Notre outil suivant est le Yémen, qui continue d’agir de façon admirable. L’un de ses traits les plus révolutionnaires réside dans sa quête infatigable de tout moyen d’exercer des pressions. La rage et l’urgence qui modèlent sa prise de décision sont des signes de véritable volonté révolutionnaire. Il est très vrai que le sang de ses dirigeants bout à chaque image en provenance de Gaza.
Le dernier outil est l’endurance même de Gaza et la légendaire capacité de ses combattants à bousculer l’ennemi. Ici, le sionisme est confronté à un dilemme stratégique : il n’est pas parvenu à rompre la cohésion interne de Gaza ni à créer des divisions entre son peuple et la résistance. Même ceux qui s’opposent au Hamas savent qu’ils partagent le même sort. Les deux camps savent que leur seul salut réside dans la libération des captifs. Et, en ce qui nous concerne, qui d’entre nous aurait le cœur de regarder les Gazaouis bien en face et de leur dire : tenez encore un peu ?
Dans ce diagnostic stratégique, il est de notre devoir de soutenir ces trois outils : la pression mondiale, le front fortifié au Yémen et la résilience inébranlable de Gaza. Le soutien peut se faire par des mots, des fonds et une persévérance similaire à celle du Yémen. Si la réponse à long terme à que faut-il faire ? réside dans la réactivation des outils de la Seconde Intifada, la question urgente du moment est alors celle-ci : La folie de Netanyahou va-t-elle déclencher le réveil des outils qui l’ont précédée ? Même si cela prend la forme d’une violence insensée face à une impasse totale ?
*****
Ce texte est une traduction de la version en anglais d’un article (qui a d’abord été publié en arabe), publié le 24 mai 2025 sur Al’Akhbar
Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine