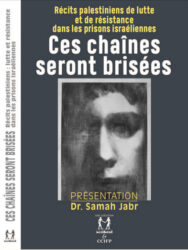Gaza, le massacre du 14 mai 2018 : près de 60 morts et 1.500 blessés. Mais cela fait bien longtemps que les chiffres ne comptent presque plus, on hésite donc à les écrire : demain, il y aura peut-être un nouvel assaut sur des manifestants non armés et un nouveau décompte macabre.
Rien de bien surprenant : après tout, cela n’arrive-t-il pas régulièrement à Gaza ?
Cette banalisation, tout Palestinien qui vit à l’étranger, singulièrement dans un pays occidental, y est systématiquement confronté, au fur et à mesure que les drames qui frappent sa terre natale se succèdent depuis 70 ans.
Devenus porte-parole malgré nous, il nous incombe de répéter inlassablement l’évidence : non, les Palestiniens ne sont pas particulièrement désireux de mourir. Pour convaincre, on peut certes s’appuyer sur des faits politiques, des chiffres, un résumé de l’histoire de 1948 à nos jours, quelques arguments éprouvés et efficaces ; souvent, une poignée d’anecdotes personnelles…
Seulement voilà : personne ne peut faire preuve d’une empathie permanente et infinie envers toutes les tragédies du monde.
La mémoire sédimente et confond les exactions israéliennes : Gaza 2014 ou Gaza 2018, ou Gaza tous les deux ans, c’est pareil. Tout finit par devenir une vaste compote de chiffres et de discours et contre-discours, une répétition fort souvent lassante pour l’étranger qui a déjà suffisamment de mal à faire la différence entre Gaza et la Cisjordanie. Comment, alors, s’attendre à une mobilisation ?

Une affaire de dictionnaire
Cette fois, la chose est assez rare pour être notée, la plupart des gouvernements (à l’exception des États-Unis) et des médias occidentaux ont commenté les événements avec plus de correction que d’habitude.
Certes, les Palestiniens continuent à mourir comme si la mort surgissait du ciel, sans agent, comme s’il n’y avait pas, de l’autre côté, un sniper qui visait avec précision les jambes, la tête, le cœur.
Certes, on parle d’« affrontements », comme si on pouvait vraiment établir une proportionnalité entre des manifestants désespérés et sans armes, et l’une des armées les plus puissantes de la terre. Mais globalement, on s’en sort un peu mieux.
C’est alors que commence la guerre de communication.
On hésite à dire « massacre », quand on est un journal « sérieux »
Israël qualifie les manifestants de terroristes et lance ses nombreux ambassadeurs informels sur les chaînes de télévision du monde entier pour expliquer qu’en conséquence, abattre des gens dans le dos ou assassiner des paraplégiques relève d’un usage modéré et proportionné de la force.
« Terroristes », le mot est lancé et s’insinue dans le discours public. Au regard des morts et des familles dévastées à Gaza, il peut paraître cynique d’affirmer que désormais la guerre est une affaire de dictionnaire.
Pourtant, force est de constater que le vocabulaire correct de ce qui se déroule en Palestine est rarement utilisé.
On hésite à dire « apartheid », voire « massacre », quand on est un journal sérieux. Un « nettoyage ethnique » en 1948 ? N’en parlons même pas.
Dire que la société israélienne est « complice » – et non pas victime – de son gouvernement ne fait pas bon genre. On préfère s’imaginer que les gouvernements ne sont pas élus et que l’armée fonctionne hors sol, que tous deux s’imposent à une population innocente et crédule.
Un autre abus de langage particulièrement pernicieux au sujet de Gaza a fait son grand retour : on en parle comme d’une « prison à ciel ouvert ». La métaphore voudrait communiquer l’horreur du blocus illégal imposé par Israël sur la bande de Gaza. L’effet est inverse : parler d’une « prison » à ciel ouvert, c’est recourir à un vocabulaire judiciaire qui dessine, en creux, l’idée que tout cela n’est pas si arbitraire ; c’est mettre la justice – inique ou non – du côté d’Israël.
Se raconter au monde
C’est que de ce côté du monde, pour des raisons sur lesquelles il n’est guère besoin de revenir, on s’identifie plus facilement aux Israéliens. En revanche, on ne s’imagine pas vraiment ce que vit un Palestinien ; et puis, au fond, il ne nous ressemble pas. C’est sans doute aussi là que commence leur « déshumanisation », notamment pointée du doigt par un éditorial publié le lendemain du drame par le quotidien français Le Monde.
La culture, au sens large, redevient donc une arme décisive.
La Palestine pouvait se targuer auparavant de produire de grandes figures intellectuelles, dont Mahmoud Darwich, Edward Said ou Ghassan Kanafani, sont les plus connues.
Avec leur disparition, on aurait pu penser que le relais ne serait pas pris. Or, aujourd’hui, c’est la société civile tout entière qui se tourne vers la culture.
De nombreux Palestiniens, ayant constaté l’échec cuisant du discours politique, trouvent dans la création le meilleur moyen de devenir maîtres de leur destin.
C’est un terrain de bataille fertile dont l’enjeu est de rendre la vie aux Palestiniens ; d’apposer des regards aux visages déshumanisés des morts ; de dessiner une vie et une intimité derrière ces centaines de milliers de personnes à qui l’on a imposé de rester des fantômes.
Ici réside aussi notre combat : changer le langage pour faire comprendre que la justice est du côté des Palestiniens.
Changer le langage, car c’est lui qui permet d’agir. Les histoires, seules, mobilisent : il nous faut trouver les mots pour se raconter au monde et reprendre le contrôle des récits qui sont faits sur nous.
Les effets se font déjà ressentir et la machine de guerre idéologique israélienne commence lentement à se fissurer : il deviendra de plus en plus ardu de feindre d’ignorer qu’un Palestinien est avant tout un être humain.
Publié le 19/5/2018 sur L’Orient Le Jour

Karim Kattan est écrivain, doctorant en littérature comparée à l’Université Paris-X, et cofondateur d’el-Atlal, une résidence d’artistes à Jéricho. Dernier ouvrage : Préliminaires pour un verger futur (Elyzad, 2017).