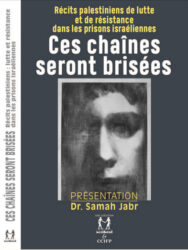June Jordan : Chants de Palestine et du Liban
A nous, les féministes arabes de ma génération, June Jordan nous a fait sortir de l’invisibilité. Elle a incarné la solidarité féministe transnationale bien avant qu’elle n’ait été en vogue.
par Therese Saliba
Cette intrépide femme noire, cette brillante poétesse ne s’est jamais retenue d’exprimer des vérités horribles. Elle a visité les camps de réfugiés palestiniens après le massacre de Sabra et Chatila en 1982. Elle est retournée au Liban après le massacre par Israël de réfugiés du camp de l’ONU à Qana, en 1996.
Jordan a transformé les plus atroces des horreurs de notre monde – le monde de l’isolement arabe et de l’incessante violence impérialiste – en de fulgurants poèmes et articles qui parlaient à notre humanité partagée au-delà des frontières de race, de classe, de croyance et de culture, par-delà des océans d’ignorance et d’incompréhension.
Elle a partagé le café arabe avec des gens en deuil, elle a apporté des témoignages sur l’étranglement de l’occupation israélienne et sur cet arsenal de mort sponsorisé par les Etats-Unis et, via ses écrits, elle a associé nos souffrances à la terreur du racisme envers les noirs et de la violence policière aux Etats-Unis.
Elle a affirmé notre combat collectif, notre résistance et notre résilience par un retentissant « Je pense que nous pouvons » (1985, pp. 45-46).

Jordan a été l’une des premières féministes afro-américaines à témoigner sa solidarité en voyageant au Liban, en produisant une poésie envoûtante qui accusait de façon tranchante le gouvernement américain et ses citoyens de la violence qui régnait là.
Dans « Apologies to All the People in Lebanon » (Mes excuses à tous les citoyens du Liban), elle engage sa propre complicité, en tant que contribuable, au nom de tout le peuple :
« Je ne savais pas ; puis personne ne m’avait rien dit et que pouvais-je faire ou dire, de toute façon ? »
Après toute une litanie d’excuses officielles et de détails horribles des massacres, elle conclut :
« Oui, je sais que c’était l’argent que je gagnais en tant que poétesse qui payait les bombes et les avions et les chars qu’ils ont utilisés pour massacrer votre famille… Je suis navrée, réellement navrée » (1985, p. 106).
Ce texte satirique des plus cinglants dénonce les fausses excuses, le refus d’avouer et de témoigner sa solidarité, l’inanité des excuses face à cette invasion menée de façon brutale.
Par la suite, les voyages de Jordan au Liban lui permettront d’examiner plus profondément cette question de la solidarité.
Son poème « Moving Towards Home » (Prendre le chemin de la maison) (1985, pp. 132-134) reproduit la longue liste d’horreurs qu’elle a vues dans les camps de Sabra et Chatila. En débutant chaque strophe par « Je ne veux pas parler de… ni de… », elle parle alors de bulldozers qui enterrent les morts dont les bras et les jambes dépassent de la bouillie rouge, de « cris longs comme une nuit », de familles forcées d’assister à des massacres d’enfants et de mères ou d’épouses.
De façon significative, Jordan utilise une construction négative afin de dénoncer les mécanismes de la réduction au silence, même si elle témoigne elle-même de ces « événements horribles ».
Le poème enclenche à nouveau sur « [son] besoin de parler d’espace vital » et sur son « besoin de parler de la maison ». Ici, Jordan insiste sur un besoin de normalité, telle qu’elle est représentée par l’espace vital – ce besoin d’espace pour vivre – avec ses implications ironiquement amères du Lebensraum allemand laissées comme une accusation. Jordan conclut par ses vers aujourd’hui célèbres :
I was born a Black woman
and now
I am become a Palestinian
Against the relentless laughter of evil
There is less and less living room
And where are my loved ones?
It is time to make our way home.Je suis née noire
et aujourd’hui
je suis devenue palestinienne
Face au rire inlassable du mal
il y a de moins en moins d’espace vital
Et où sont tous mes bien-aimés ?
Il est temps que nous rentrions chez nous
Jordan ne s’étend pas sur sa marginalisation en tant que noire et son identification aux Palestiniens, mais c’est pour mieux mettre en évidence ensuite sa connexion privilégiée avec ceux qui rentrent chez « nous », tandis que les vies d’autres personnes et leurs maisons ont été détruites.
Dans ce processus où elle devient l’autre, les lignes entre le premier « je (…) palestinienne » et « mes (…) chez nous » se mélangent en un chagrin collectif qui fait route vers une sorte de « chez nous » dans le monde.
Jordan en est venue à croire que ce n’était pas la désinformation qui a perpétué le massacre au Liban, mais plutôt une déshumanisation raciste.
« Le problème était que le peuple libanais en général et le peuple palestinien en particulier ne sont pas des blancs : Ils n’ont jamais été des blancs. Ce qui fait qu’ils n’étaient et ne sont toujours que des Arabes, ou des terroristes, ou des animaux. Ils n’étaient certainement ni des hommes, ni des femmes, ni des enfants ; ils n’étaient certainement pas des êtres humains avec des droits comparables, même de loin, aux droits des blancs, aux droits d’une nation de blancs » (2002, p. 191).
Dans « Eyewitness from Lebanon » (Témoin oculaire au Liban) (1996), elle écrivait :
« Je suis allée au Liban parce que je crois que les peuples arabes et les Américains arabes occupent la place la plus basse, la plus méprisée de l’esprit raciste en Amérique. J’y suis allée parce que je crois qu’être musulman et arabe, c’est être un peuple en proie aux brimades les plus désinhibées, les plus mortelles possibles. »
Jordan a également compris que parler de la Palestine était
« l’ultime tabou, un tabou derrière lequel le sort d’un peuple tout entier, les Palestiniens, pouvait être totalement effacé » (2002, p. 193).
En face des accusations vicieuses d’antisémitisme et de « l’horrible détermination des blancs dans ce pays à réduire au silence ou à discréditer la dissension américaine », Jordan ne laisse pas de se demander à quoi ressemblerait la vie après le Liban (p. 193).
Plus tôt, elle avait identifié les divisions « apparemment inconciliables » entre les communautés féministes et celles de gauche d’une part et « celles pour lesquelles Israël restait un sujet sacrosaint exempt de discussion rationnelle et de dispute » ainsi que « celles pour lesquelles Israël ressemblait beaucoup à un autre pays dirigé par des blancs, dont le militarisme avait tendance à entraîner des conséquences racistes… » (p. 193)
« Life after Lebanon » (La vie après le Liban ) (1985) signale un changement de cap – pour Jordan et pour tous les écrivains. Elle a perçu la réduction au silence du débat comme un affront à la vie intellectuelle et morale de notre pays. Pour cette raison, Jordan – à l’instar de tant d’autres (Arabes, Juifs et autres alliés) – a subi des calomnies, la censure, et des distorsions de ses propos.
C’est dans une large mesure à cause de ce prix – qu’elle a payé d’aussi bonne grâce – qu’aujourd’hui nous avons une dette envers Jordan et sa voix insistante qui a préparé la voie à ceux qui ont suivi.
Jordan n’a jamais craint de parler de l’indicible et de rompre les silences qui s’envenimaient entre nous. Pour Jordan, ces silences tournaient autour de ses « droits homosexuels » ou de sa bisexualité, et autour de la Palestine – des problèmes qu’elle percevait comme étant ceux qui se voyaient le plus réduits au silence dans la société américaine (« A Place of Rage » (Un endroit de vive colère), 1991).
En tant que féministes, nous avons toutes ressenti ces espaces explosifs, ces échanges « requérant des acrobaties de reniement de soi » (1981, p. 182). Jordan nous a rappelé que ces silences devaient être comblés par la parole ou qu’il fallait les faire exploser, en dépit de la censure, des brimades, du risque de compromission des amitiés.
Elle nous a ramenés au début des années 1980, quand il n’y avait pas que le Liban à être engagé dans une prétendue « guerre civile », mais qu’il y avait une profonde histoire et une confrontation entre noirs et blancs toujours en cours dans notre propre pays, laquelle confrontation ressemblait grandement à une guerre civile.
Elle a insisté et établi des analogies claires entre le racisme anti-arabe et l’histoire résonante du racisme envers les noirs que les Américains sont nettement plus disposés à comprendre.
Et ses propos ont été prophétiques à propos de la violence incessante, néanmoins largement acceptée, envers les Arabes et les musulmans qui n’allait pas tarder à suivre sous le déguisement d’une « guerre mondiale contre le terrorisme ».
Dans le sillage du 11 septembre (2001) et quelques mois avant sa propre mort, Jordan a rédigé l’introduction de son recueil final, Some of Us Did Not Die (Certains d’entre nous ne sont pas morts, 2002).
Sa critique cinglante de la complicité américaine, l’Etat sécuritaire sous le déguisement de la démocratie et sa célébration de la résistance, sont en résonance avec ses premiers écrits.
Je porte ses chants de résilience dans mon esprit et je me demande ce qu’elle aurait pu écrire aujourd’hui, après les massacres israéliens au Liban (2006) et à Gaza (2009, 2014), après la destruction laissée par les invasions américaines en Afghanistan et en Irak. Et, aujourd’hui, avec les meurtres incessants d’hommes et de femmes noirs, je reprends ses mots du « Poem about Police Violence » (Poème sur la violence policière, 1974) :
« Que pensez-vous qu’il se passerait si / chaque fois qu’ils ont tué un jeune noir, nous avions ensuite tué un flic ? »
Ce n’est qu’une simple question, néanmoins percutante, qui pointe au cœur du racisme et du pouvoir et de la violence d’Etat. Les mots et l’activisme de Jordan étaient visionnaires ; en exprimant sans détour des vérités incisives et en établissant des connexions au travers des luttes, elle était en avance sur son temps.
Aujourd’hui, une vidéo circule, When I see them, I see us (Quand je les vois, je nous vois) – un montage de poésie et d’images juxtaposant la violence contre les noirs et la violence de l’occupation israélienne, avec des déclarations de Black-Palestinian Solidarity – c’est l’un des legs de Jordan.
Dans « Civil Wars » (Guerres civiles) (1981), Jordan raconte comment la communauté activiste se rassemble dans le sillage d’une autre crise encore et qu’elle initie des rituels de comportement « poli ». Elle critique la façon dont
« les courtoisies de l’ordre … émanant d’un cœur frappé par la rage ou la terreur ou le chagrin … atténuent et déforment la vérité motivante de la réponse critique humaine à la douleur » (p. 179).
June a vécu dans nos espaces vitaux, après les pires massacres, elle a exprimé ces atrocités innommables et le chagrin, la terreur et la rage qui étaient dans nos cœurs. Jamais elle n’a déformé nos vérités à l’aide de jolies subtilités. Elle a reconnu :
« A la fin de ce siècle le massacre / reste invisible à moins que la peau / de la victime ne soit perçue comme blanche » (1985, p. 127).
Elle a trouvé la force dans la fermeté du cèdre libanais, dans la résistance palestinienne. Elle nous appelait sa famille. Voici mon chant dédié à June Jordan, qui n’est pas morte car, comme elle l’a écrit, « Ma vie semble être une révélation croissante de la face intime de la lutte universelle » (1981, p. xi).
Cette face intime – noire, arabe, homo, nicaraguayenne, sud-africaine, cubaine, palestinienne, libanaise, femme – continue à vivre dans ses mots.
Bibliographie
Civil Wars : Selected Essays, 1963-80 (Guerres civils : essais choisis, 1963-1980) (Boston : Beacon Press, 1981), pp. ix-xii, 178-186.
« Eye Witness in Lebanon » (Témoin oculaire au Liban), dans The Progressive (août 1996), p. 13.
Living Room: New Poems, 1980-1984 (Espace vital : nouveaux poèmes, 1980-1984) (New York : Thunder’s Mouth Press, 1985), pp. 45-46, 104-106, 127, 132-134.
« Life After Lebanon » (La vie après le Liban), dans Some of Us Did Not Die: New and Selected Essays of June Jordan (Certains d’entre nous ne sont pas morts : nouveaux essais choisis de June Jordan) (New York ; Basic/Civitas Books, 2002), pp. 187-195.
Publié le 24 mars 2016 sur The Feminist Wire
Traduction : Jean-Marie Flémal
 Therese Saliba est membre de la faculté des études féministes du tiers-monde à l’Evergreen State College de Washington et elle est une ancienne boursière Fulbright en Palestine. Elle a participé à la composition et à l’édition de Gender, Politics and Islam (2002) et de Intersections: Gender, Nation and Community in Arab Women’s Novels (2002). Ses essais et articles ont été publiés dans Arab & Arab American Feminisms, Arabs in America, Food for Our Grandmothers, et dans d’autres recueils et publications périodiques. Saliba fit partie du bureau de consultance de l’Encyclopedia of Women and Islamic Cultures (en ligne) et de la Gaza Mental Health Foundation, et travaille localement avec la Rachel Corrie Foundation for Peace & Justice.
Therese Saliba est membre de la faculté des études féministes du tiers-monde à l’Evergreen State College de Washington et elle est une ancienne boursière Fulbright en Palestine. Elle a participé à la composition et à l’édition de Gender, Politics and Islam (2002) et de Intersections: Gender, Nation and Community in Arab Women’s Novels (2002). Ses essais et articles ont été publiés dans Arab & Arab American Feminisms, Arabs in America, Food for Our Grandmothers, et dans d’autres recueils et publications périodiques. Saliba fit partie du bureau de consultance de l’Encyclopedia of Women and Islamic Cultures (en ligne) et de la Gaza Mental Health Foundation, et travaille localement avec la Rachel Corrie Foundation for Peace & Justice.
Trouvez ci-dessous la bande de lancement du film « A Place of Rage » (1991) avec June Jordan, Angela Davis et Alicia Walker, et la vidéo, When I see them, I see us (2015).
A Place of Rage from Kali Films on Vimeo.