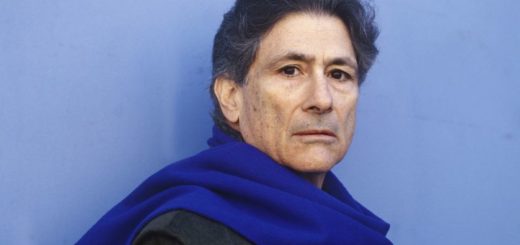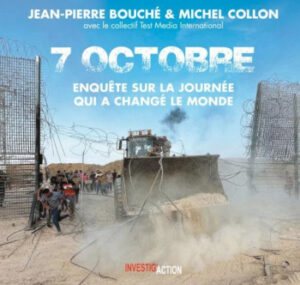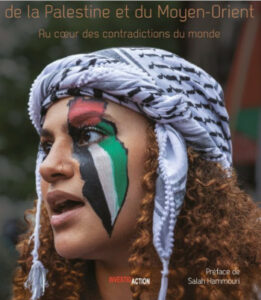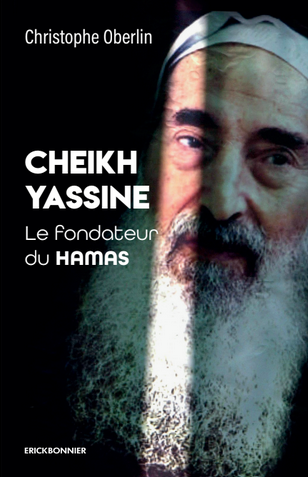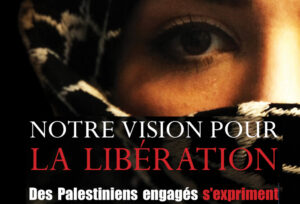Retirer le Hamas de la liste : Pourquoi mettre un terme à la désignation de « terroriste » est-il juridiquement viable et urgent politiquement ?
Le retrait du Hamas des listes terroristes, loin d’être un exercice sémantique, recalibrerait les lois internationales, transformerait l’engagement diplomatique et restaurerait la légitimité de l’autodétermination palestinienne.

Deux femmes, deux fronts : Francesca Albanese (à gauche) et Charlotte Kates – des voix qui défient l’architecture de la criminalisation.
Rima Najjar, 10 juillet 2025
Quid, si supprimer une étiquette pouvait débloquer l’aide humanitaire, la légitimité politique et les lois internationales ?
Le cadrage persistant de la résistance armée palestinienne en tant que terrorisme reste l’une des barrières les plus stratégiquement ancrées si l’on veut résoudre le conflit israélo-palestinien. Au centre de cette impasse figure la proscription du Hamas par les principaux États occidentaux, en particulier le Royaume-Uni et les États-Unis – des désignations qui légalisent l’exclusion politique, suppriment la médiation internationale et déforment la compréhension au niveau mondial des mouvements de libération.
Le retrait du Hamas des listes terroristes, loin d’être un exercice sémantique, recalibrerait les lois internationales, transformerait l’engagement diplomatique et restaurerait la légitimité de l’autodétermination palestinienne. En cas de réussite, cela marquerait un point d’inflexion historique – lequel dénoncerait l’architecture de la criminalisation et réorienterait les cadres mondiaux de responsabilisation vers la justice et la résolution de certains problèmes.
Cette transformation juridique et politique se déroule activement au Royaume-Uni. L’application de la Loi Riverway de 2024 au ministère de l’Intérieur, soumise sous la Section 4 de la Loi de 2000 sur le terrorisme, conteste la désignation du Hamas pour des motifs liés aux droits humains. La soumission prétend que l’étiquette de couverture viole la Convention européenne sur les droits humains – en particulier les droits à la liberté d’expression, d’association et de protection vis-à-vis de la discrimination.
Chose très importante, elle souligne que le Hamas, en tant qu’autorité civile de fait à Gaza, gère des hôpitaux, des écoles et des infrastructures et que criminaliser l’engagement envers ces institutions sabote l’aide humanitaire, le journalisme et la diplomatie. L’application est rejointe par CAGE International, dont le plaidoyer dénonce à quel point les lois contre-terroristes ont ciblé disproportionnellement les musulmans britanniques et les organisateurs de la solidarité avec la Palestine. Leur dossier fait état d’une surveillance très répandue, de perturbations de l’emploi et de perquisitions, prétendant que la proscription criminalise la dissension et racialise le discours politique.
L’une des victimes les plus visibles de ce régime est Charlotte Kates, coordinatrice internationale du Réseau Samidoun de solidarité avec les prisonniers palestiniens. Son organisation a été confrontée à une criminalisation au niveau mondial – très récemment, via la désignation au Canada de Samidoun en tant qu’entité terroriste et via les calomnies répandues sur son compte par le Trésor américain qui l’a traité de « fausse œuvre caritative » – en raison de ses liens supposés avec le Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP), lui-même proscrit.
Charlotte Kates a été ciblée par des enquêtes sur les crimes de haine, par des interdictions de séjour et par la censure institutionnelle, non pas pour des actes de violence, mais pour sa défense ouverte de la résistance palestinienne et son encadrement juridique des prisonniers en tant que combattants politiques conformément au droit international. Son témoignage de spécialiste dans l’application de Riverway définit les prisonniers comme étant « la boussole morale de la résistance » et affirme que la proscription efface l’identité politique et détruit les protections juridiques garanties par les Conventions de Genève. Le ciblage de Samidoun ne réduit pas seulement la solidarité au silence – il exemplifie la façon dont on se sert des désignations terroristes pour délégitimer la défense juridique et la protection culturelle.
Alors que le gouvernement britannique a rejeté la contestation jusqu’à ce jour, en citant la sécurité nationale et l’alignement sur les alliés, la voie juridique reste viable. La section 4 permet l’examen et le recours auprès de la Commission d’appel des organisations interdites et le soutien croissant émanant des coalitions étudiantes, des organes des droits humains et des experts juridiques démontre qu’il y a un changement dans les sentiments du public.
Ce qui est en jeu n’est pas simplement le statut juridique – mais une inversion dans le discours, dans lequel le Hamas n’est plus défini exclusivement par la violence militaire, mais par son rôle politique, civil et historique dans la gouvernance et la résistance palestiniennes.
Ce changement garde un potentiel de transformation en faveur de l’engagement international, en particulier dans le système de l’ONU. L’annulation de la proscription permettrait un contact diplomatique officiel avec l’administration civile du Hamas, débloquant la coordination des efforts humanitaires et des négociations de paix inclusives. Cela mettrait également l’ONU sous pression afin qu’elle réaffirme sa position opérationnelle – actuellement modelée par les désignations terroristes formulées par nombre de ses États membres – et qu’elle s’aligne plus étroitement sur ses propres mandats au niveau des droits humains. Un tel recalibrage étendrait le mandat de Francesca Albanese en neutralisant les attaques politiques enracinées dans la proscription et en lui permettant de poursuivre des cadres de justice transitionnels sans obstruction. Son travail, en particulier son répertoriage de la complicité des entreprises et de la jurisprudence de la résistance, ne serait plus rejeté en tant qu’« apologie du terrorisme », mas reconnu comme essentiel pour le droit international et la responsabilisation.
Au cœur de cette transformation se trouve un défi épistémique plus profond – la compétition pour savoir qui peut nommer, raconter et légaliser la résistance. L’ONU a longtemps lutté pour définir le terrorisme d’une façon qui fait la distinction entre actes de violence et actes de libération. L’annulation de la proscription révèle les lacunes et les partialités de ces cadres, qui privilégient les acteurs d’État et marginalisent la lutte anticoloniale. Elle ouvre également de l’espace permettant aux traditions légales du Sud mondial de remodeler les normes internationales et de réaffirmer la légitimité de la résistance armée sous occupation.
Cette légitimité a des implications directes pour la Cour pénale internationale, où le statut de proscription du Hamas a déformé l’engagement juridique. L’annulation de la proscription permettra à la CPI d’enquêter à la fois sur les acteurs étatiques et non étatiques avec une symétrie juridique, sans l’obstruction de l’exceptionnalisme diplomatique. Les dirigeants du Hamas pourraient participer aux procédures, soumettre des preuves et être tenus responsables en tant qu’acteurs reconnus au sein du système – plutôt qu’en tant qu’entités criminalisées de façon préemptive.
Les lois humanitaires elles aussi seraient redynamisées. La proscription a débouché sur la criminalisation de l’aide en bloquant l’accès aux hôpitaux et aux institutions civiles gérés par le Hamas. Ceci viole les principes fondateurs du droit international humanitaire, y compris la neutralité médicale et la protection des civils. L’annulation de la proscription restaurerait la distinction entre combattants et administrateurs, permettant aux ONG et aux agences internationales d’opérer sans crainte d’arrestation ou de voir ses avoirs gelés.
Les répercussions s’étendent aux médias, aux universités et à la mobilisation de la diaspora. Les médias traditionnels seraient forcés de recadrer les récits de la résistance palestinienne, passant des tropes binaires du genre « terreur versus démocratie » à une couverture complexe et historicisée.
Les médias alternatifs et le journalisme juridique se porteraient bien, en élevant l’analyse critique et en amplifiant les voix marginalisées. Les institutions académiques reconquerraient de l’espace intellectuel, en se débarrassant du climat de crainte qui a censuré les programmes de cours, la recherche et l’organisation des étudiants. L’annulation de la proscription permettrait à des professeurs d’enseigner l’évolution politique du Hamas, les mouvements de résistance comparatifs et les cadres juridiques post-coloniaux sans risque de représailles institutionnelles.
Les réseaux de défense de la diaspora – longtemps fragmentés par la surveillance et par la criminalisation – seraient revitalisés. L’annulation de la proscription ré-autoriserait la mobilisation, la coordination et le discours public, donnant la possibilité aux gardiens de la culture et aux activistes juridiques comme Charlotte Kates de revendiquer leur rôle en modelant le futur de la Palestine. L’évolution de la Législation Riverway en Riverway to the Sea exemplifie ce changement. Jadis une entreprise d’immigration conventionnelle, Riverway s’est restructurée en 2025 sous forme d’une formation juridique directement intégrée au mouvement de libération – supprimant les barrières traditionnelles entre avocats conseillers juridiques (barristers) et avocats représentants devant les tribunaux (solicitors), rejetant les modèles légaux hiérarchiques et alignant sa mission sur le contentieux stratégique, l’éducation juridique et la coordination transnationale. Même son nom – qui fait écho au slogan « From the river to the sea » (du fleuve à la mer) – signale une adhésion sans réserve à la clarté et à la conviction idéologique. Ce n’est pas simplement un changement de nom, mais un pivot structurel : de la défense juridique au défi juridique, de la fourniture de services à l’insurrection épistémique.
Même le royaume de la production culturelle et de l’infrastructure épistémique – les musées, les archives, les programmes de cours – est prêt à être transformé. La levée de la proscription permettrait aux curateurs de présenter la résistance palestinienne dans son entière complexité historique et politique. Elle soutiendrait la numérisation et la préservation des lettres de prisonniers, des minutes de la gouvernance civile, des récits oraux, en les intégrant aux archives mondiales sans crainte de subir la censure ou des poursuites.
En somme, la suppression du Hamas des listes terroristes n’est ni une faveur politique ni un pari diplomatique – c’est une nécessité juridique et éthique. Elle permet la justice transitionnelle, re-calibre les lois humanitaires, légitime la gouvernance civile et décolonise la narration mondiale. Elle donne la possibilité à des personnalités comme Francesca Albanese et Charlotte Kates d’agir avec une précision de principe en libérant la résistance du joug de la criminalisation. De façon plus profonde encore, elle ouvre la voie à une re-narration de l’Histoire, non pas via l’exclusion, mais via la reconnaissance – et la justice.
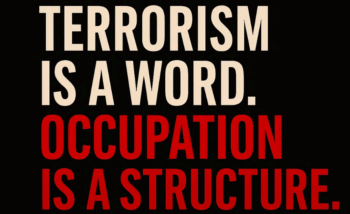
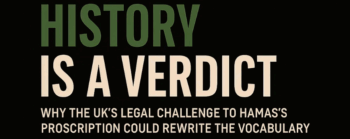
LE TERRORISME EST UN MOT.
L’OCCUPATION EST UNE STRUCTURE.
L’HISTOIRE EST UN VERDICT.
POURQUOI LE DÉFI BRITANNIQUE À LA PROSCRIPTION DU HAMAS POURRAIT RÉCRIRE LE VOCABULAIRE.
Un défi juridique audacieux au Royaume-Uni pourrait récrire les règles d’engagement
et désintégrer le vocabulaire de l’occupation.
Ce n’est pas simplement de la sémantique juridique – c’est aussi de l’oxygène historique. L’étiquette de terrorisme a longtemps été un outil étatique en vue de criminaliser les mouvements qui s’opposent à l’occupation, à l’apartheid et au colonialisme de peuplement. Elle a été utilisée contre l’ANC. Elle a été utilisée contre le Sinn Féin. Et si elle est renversée ici, cela marquerait le changement de narration le plus significatif de la Palestine depuis Oslo.
Cette transformation, attendue depuis longtemps, n’est plus hors de portée. Le climat politique qui entoure la Palestine a considérablement changé, ces dernières années – depuis les couloirs des lois internationales aux rues de la protestation mondiale. Les mobilisations massives dans toute l’Europe, l’Amérique latine et les États-Unis ont dépassé les appels au cessez-le-feu pour exiger une justice structurelle.
La visibilité de la résistance palestinienne, longtemps confinée aux marges de l’activisme, sature désormais le discours traditionnel. Les juristes internationaux émettent des mandats d’arrêt contre les hauts responsables israéliens. Des experts de l’ONU comme Francesca Albanese défient l’impunité en recourant à la précision juridique, et non à la polémique. Malgré la criminalisation, des organisations comme Samidoun continuent de s’organiser par-delà les frontières, rassemblant du soutien auprès des artistes, des étudiants et des coalitions juridiques.
L’architecture du silence se lézarde et, en même temps, la forteresse de la proscription. En ce moment – alors que le coût de la censure devient politiquement insupportable – la levée de la proscription n’est pas simplement réalisable, elle devient stratégiquement vitale. Elle donne la possibilité aux diplomates, aux enseignants, aux journalistes et aux avocats de s’engager véritablement et légalement envers les réalités de la résistance, sans crainte de représailles ou d’oblitération. Mettre un terme à la désignation terroriste ne change pas seulement le langage – cela débloque la possibilité légale et la clarté historique. Et, de la sorte, cela restitue aux Palestiniens ce que des décennies de proscription leur ont refusé : le droit non seulement de résister, mais de se faire entendre, d’être nommés par leur nom et compris.
Mettez un terme à la désignation terroriste et vous ne changerez pas seulement de politique, vous démantèlerez le vocabulaire de la domination. Vous décoloniserez le dictionnaire. Et, ainsi, vous rendrez aux Palestiniens ce que des décennies de proscription leur ont refusé : le droit non seulement de résister, mais le droit d’être compris.
*****
 Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.
Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.
*****
Publié le 10 juillet 2025 sur le blog de Rima Najjar
Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine
Lisez sur le même sujet :
Le Hamas lance une affaire juridique sans précédent en Grande-Bretagne
La déclaration de témoin d’Abou Marzouk : Le Hamas n’est pas une organisation de terreur mais un mouvement de libération
Le rapport d’expertise de Charlotte Kates : La position centrale du mouvement des prisonniers palestiniens dans la lutte de libération pour la Palestine
Le rapport d’expertise de Jonathan Cook : L’effet dissuasif des pouvoirs contre-terroristes sur le journalisme
*****
Lisez également ces articles de Rima Najjar, publiés sur ce site :
Génocide et déplacement en tant que négociation : la logique immuable du Plan Dalet
La dignité comme levier : Un contre-cadre pour les négociations des prisonniers palestiniens
Ce qui se cache derrière les retombées de Glastonbury
Le paradoxe de la philosophie israélienne de la « victoire totale »
Oum Kalthoum, l’Iran et les gouvernements et médias occidentaux
La Palestine et l’Iran peuvent être durement touchés et continuer d’aller de l’avant
Exiger une justice qui transcende la destruction
La Résistance palestinienne à l’action à Bruxelles