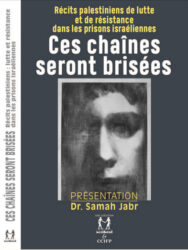Une affaire de blues palestinien
En enregistrant en pleine quarantaine Covid, un trio de musiciens confère une solide coloration arabe à un classique du blues, tout en explorant de nouvelles voies en vue de la solidarité entre les noirs et les Palestiniens.

Sans titre, extrait de la série « Islam Played the Blues » (L’Islam faisait du blues), par Toufic Beyhum. (Photo : www.tbeyhumphotos.com)
Henriette Chacar, 3 septembre 2021
Tout en lisant, vous pouvez écouter notre liste de morceaux fournis par Spotify et qu’a inspirés cette histoire.
Pour Kareem Samara, un multi-instrumentiste britannico-palestinien, compositeur et artiste du son, c’était naseeb — cela devait se faire. Un jour, en 2020, le cinéaste américano-palestinien et producteur de musique, Sama’an Ashrawi, lui adresse un message en lui demandant de jouer sur un oud « Baby, Please Don’t Go », un standard de blues américain. Ashrawi était curieux de voir ce que le blues allait donner dans les quarts de ton de l’instrument moyen-oriental. Quelques minutes plus tard, Samara lui fit parvenir un enregistrement du morceau.
« C’est une chanson que j’ai toujours aimée », dit Samara. « Cette chanson, je la sens dans mes os. »
Ashrawi et Samara s’étaient rencontrés en 2019 en Palestine, alors que Samara visitait la région afin de retrouver ses ascendances palestiniennes. La famille de sa mère avait fui Jaffa pour l’Égypte durant la Nakba et il était le premier de sa famille à retourner en Palestine depuis 1948. À l’époque, Ashrawi recherchait Al Bara’em, considéré comme le premier groupe de rock‘n’roll arabe original de Palestine, que son père avait lancé avec ses frères dans les années 1960.
« Baby, Please Don’t Go » est probablement une adaptation d’une chanson folklorique de l’époque de l’esclavage aux États-Unis. La plupart des variations sur le thème peuvent remonter à la version de 1935 enregistrée par le fameux bluesman du Delta, Big Joe Williams, et dont les paroles expriment la crainte d’un amant ou amoureux qui s’en va pour « retourner à La Nouvelle-Orléans ». Un des vers de la version originale – « I believe that the man done gone, to the county farm, Now with a long chain on » (Je crois que l’homme est retourné à la ferme du comté et qu’il est aujourd’hui entravé d’une longue chaîne » — suggère que le chanteur est un prisonnier implorant sa partenaire de ne pas le laisser tomber avant qu’il ne soit libéré.
Depuis, la chanson a été reprise par plusieurs poids lourds du blues et autres groupes de rock, dont Them, AC/DC et les Rolling Stones. Pour Ashrawi, toutefois, la version qui est restée en lui est celle du célèbre chanteur de blues et novateur de la guitare, Samuel John « Lightnin’ » Hopkins. « Le riff à la guitare dans cette version de Hopkins est si mémorable… Je l’aurai toujours dans la tête », dit-il.
Samara a suggéré qu’ils fassent un morceau avec le vieil enregistrement.
« Il a dit quelque chose comme ‘Tu connais quelqu’un qui pourrait le chanter à partir de ceci ?’ Et la première personne à laquelle j’ai pensé, c’était mon amie Kam Franklin »,
se souvient Ashrawi. Franklin, une compositrice de chansons, principale chanteuse du groupe soul texan The Suffers, a accepté l’invitation.
« Pour moi, cela me semblait très spécial d’avoir Kam au chant et je voulais être sûr qu’il y avait l’un ou l’autre élément en plus uniquement pour sa voix et qui faisait vraiment de cette version le truc de Kam »,
dit Ashrawi. Et c’est alors qu’il imagina de remplacer « New Orleans » dans les paroles originales par « Third Ward », le quartier de Houston, au Texas, où vit Franklin et où Lightnin’ Hopkins vivait lui aussi.
C’est là aussi que George Floyd, un noir dont le meurtre des mains d’un policier à Minneapolis l’an dernier avait déclenché une vague mondiale d’indignation, avait grandi et encadré des jeunes.
« Les noirs américains ont témoigné leur solidarité envers la Palestine, et nous avons témoigné la nôtre en retour, mais peut-être pas suffisamment »,
dit Samara.
« C’est une magnifique façon de témoigner sa solidarité, et peut-être d’une façon qu’on n’avait jamais vue auparavant. »
Ce qui avait débuté comme une brève collaboration presque par hasard se mua en un nouveau groupe appelé Azraq, c’est-à-dire « bleu » en arabe, composé d’Ashrawi, de Franklin et de Samara. Malgré les retards dus à la Covid-19, le trio travaille sur une nouvelle musique, expérimentant avec des démos originales et des versions bluesy de chants traditionnels palestiniens.

Une peinture de Nour Bazzari, un artiste palestinien adolescent qui se spécialise dans l’abstrait et qu’a inspiré la version de « Baby, Please Don’t Go » d’Azraq. (Photo : avec l’aimable autorisation de Sama’an Ashrawi)
« En pensant à la dureté de l’oppression que les noirs ont subie dans tous les États-Unis et en pensant à la douleur et à l’oppression que les Palestiniens ont connues – dans les deux cas, c’est une douleur qui vient du colonialisme »,
réfléchit Ashrawi.
« Comment pouvons-nous rendre les sons de la Palestine en les mêlant à ceux du blues et aussi le feeling des deux ? C’est cela, l’intersection que nous explorons. »
À la recherche de l’authenticité
Quand on joue dans un groupe, la meilleure performance vient du contact oculaire et du feeling, explique Samara. Mais, avec les trois membres du groupe en quarantaine dans des villes différentes suite à la pandémie de coronavirus, WhatsApp est devenu leur moyen de rester connectés tout en travaillant sur le morceau. La musique et les paroles ont dû être enregistrés séparément « et nous n’avons pas utilisé de click », explique Samara, faisant allusion au métronome digital qui aide les musiciens à rester synchronisés.
« Il y a des trous, il y a des réflexions qui se poursuivent dans l’enregistrement, il y a parfois un retard avant l’entame d’une des mesures, il y a des moments où nous nous chevauchons. Il y a des endroits où elle (Franklin) fait quelque chose avec sa voix qui est si parfait que si je devais la prendre pour de bon, cela effacerait l’imperfection de mon jeu au moment où je l’accompagne. »
Le fait d’avoir décidé de produire l’enregistrement de cette manière, même si ça représentait un plus grand défi, lui a donné davantage un feeling « live » qui a permis au trio de rester fidèle à la nature non raffinée, improvisatrice de la musique de blues.
« J’ai toujours cherché l’honnêteté, j’ai toujours cherché une certaine authenticité dans le son »,
explique Samara. Et le blues permet non seulement aux musiciens d’avoir cette authenticité, c’est une caractéristique qui définit bien le genre.
« Avec le blues, il y a une structure, il y a une idée, il y a une échelle, mais une fois que ces gens empoignaient leur guitare, ils pouvaient faire tout ce qu’ils voulaient. »
Le studio de Samara, chez lui, où il a enregistré la musique pour la bande, est aménagé précisément pour favoriser ce son organique. La pièce, de dimensions moyennes, n’est pas insonorisée et elle donne une légère réverbération sonore, ce qui n’est pas considéré comme ce qu’il y a de mieux quand vous enregistrez de la musique.
Le processus de production de Samara, « très indépendant, très lo-fi (= de basse fidélité, NdT) », implique généralement un portable, un clavier, une batterie, un oud et une guitare. Pour cette prise, outre l’oud et le chant de Franklin, Samara a encore ajouté une guitare basse ; un riq, c’est-à-dire un tambourin traditionnel très habituel dans la musique arabe ; des darbukas arabes et kurdes, des tambours à main cintrés qu’il tenait en même temps entre ses genoux ; et des clochettes syriennes qu’on passe aux pieds et qu’un ami lui avait ramenées de Jérusalem. « Cela semble très fantaisiste et compliqué, mais ce ne l’est pas. »
La chanson commence par un son de drone que Samara a créé en se servant de son clavier. « Je suis un grand amateur de patience, d’atmosphère et de mise en scène », dit-il. Le drone, « c’était ce qu’il fallait pour donner un peu d’espace ».
Tour en discutant de la meilleure façon d’intégrer le drone et la percussion, Franklin dit qu’elle avait une idée. « Du jour au lendemain, elle a reproduit les ‘oh’ qu’on entend à la fin », dit Samara. « Cela rend cette fin bien plus lancinante et particulière. »
« La guitare ne sonne pas comme l’oud »
Ashrawi, dont le père est palestinien, a grandi à Cypress, au Texas, une ville située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Houston. Bien qu’il se souvienne d’avoir eu peu de voisins arabes, il y avait des signes identitaires arabes partout dans la maison familiale : les tatreez de sa grand-mère, des tapisseries palestiniennes brodées, ornaient les murs ; son père écoutait Fayrouz et les frères Rahbani ; même les pyjamas qu’il portait enfant, se rappelle-t-il, étaient ornés de caractères arabes.
Tout autour d’Ashrawi, lors de l’interview pour Zoom, une guirlande de couvertures de disques courait sur le mur, allant de Gil Scott-Heron, aux Commodores en passant par Ray Charles. « Cela vous donne une bonne idée de ce avec quoi j’ai grandi », dit-il. « Beaucoup de Beatles, beaucoup de Led Zeppelin. Beaucoup de jazz – tellement de jazz. »
En grandissant, Ashrawi a joué du piano et du saxophone. Parfois il flirte avec l’idée d’apprendre à jouer de la guitare, mais « pour apprendre la guitare, il faut se faire des cals aux doigts et j’aime avoir les mains douces », dit-il.
À la high school, Ashrawi économisa tout son argent de poche de l’été pour installer de gros haut-parleurs dans le coffre de sa voiture.
« J’ai toujours des amis qui se souviennent de certains morceaux que je faisais passer sur le parking de la high school »,
dit-il
on écoutait « Poppin’ My Collar » de Three 6 Mafia, et « Cocaïne » de UGK, par exemple.
À l’université, il se lança comme disc-jockey en utilisant GarageBand, un software digital de production de musique, afin de créer des rythmes sur son portable.
« J’avais des idées sur ce que je voulais entendre, mais je n’avais pas la motivation pour réaliser physiquement ces rythmes moi-même »,
dit-il. C’est à ce moment qu’il décida de s’impliquer dans la production musicale :
« Cela me donna l’idée que c’était quelque chose que je serais intéressé de faire, mais je n’aurais pas nécessairement besoin d’être celui qui appuierait sur les boutons. »
L’expérience de Samara dans la musique, d’autre part, est bien plus pratique. Il a grandi en jouant de la guitare à l’école et il a été membre de plusieurs groupes de rock. Plus tard, il a travaillé dans l’édition musicale, plaçant de la musique dans des films et enseignant la guitare.
« Ma mère faisait la fine bouche parce que la guitare ne sonnait pas comme l’oud. Si je jouais des musiques d’Oum Kalthoum ou des choses que j’avais entendues sur ses bandes »,
dit-il, en faisant allusion à l’icône égyptienne,
« je ne pouvais jamais vraiment obtenir le quart de note et ni même les gammes entières de certains des morceaux qu’ils jouaient. »
Lors de l’un de ses voyages en Égypte, il acheta un oud, mais il allait lui falloir des années pour faire preuve d’assez de confiance en soi pour en jouer.
Défier le désespoir
Le blues est un genre musical créé dans le Deep South par des Afro-Américains. Les chansons de blues racontent généralement des histoires de souffrance et de perte, et le blues est en quelque sorte aussi une lamentation destinée à atténuer la douleur. Mais le blues « a un aspect plus profond, spirituel : défier le désespoir », écrivait dans un essai récent la Dre Sylviane Diouf, une historienne spécialisée dans la diaspora africaine et boursière en visite au Centre d’étude de l’esclavage et de la justice à l’Université Brown.
Ce genre musical fut fortement influencé par les traditions musulmanes qui furent introduites aux États-Unis avec, au début du 16e siècle, la réduction en esclavage de centaines de milliers d’Ouest-Africains musulmans. On ne sait toutefois pas grand-chose de ces communautés et de leurs contributions à la culture américaine, et ce, en partie parce que l’histoire des Africains asservis a largement été ignorée, et pas toujours à dessein – de nombreux historiens n’ont tout simplement pas la compréhension des cultures africaines et islamiques et, de ce fait, ne reconnaissent pas leur existence ou leur influence dans les archives, nous a expliqué Sylviane Diouf lors d’un entretien téléphonique.
« J’ai lu des centaines de livres sur l’esclavage et sur le commerce des esclaves. Mon mémoire, quand j’étais à l’université, traitait de la résistance de la révolte dans les Amériques. Et j’ai été surprise de ne pouvoir trouver mention des musulmans »,
explique Mme Diouf. Cela l’amena à se demander pourquoi, du fait qu’il y avait des musulmans au Sénégal, au Mali et en Guinée, entre autres, nous ne pouvons les retrouver dans les livres qui ont été écrits sur l’esclavage ?

Illustration de couverture de Dana Durr pour l’’enregistrement de « Baby, Please Don’t Go ». (Photo : avec l’aimable autorisation de Sama’an Ashrawi)
Prenant les choses en main elle-même, Sylviane Diouf s’est mise à investiguer des sources en français, en anglais, en espagnol, en portugais, découvrant une riche histoire néanmoins très négligée. « Si vous cherchez quelque chose, vous le trouvez », dit-elle. Ses découvertes furent d’abord publiées dans un livre de 1998 intitulé « Servants of Allah » (Les serviteurs d’Allah). Une seconde édition vit le jour en 2013.
De ses recherches, Mme Diouf apprit que les histoires des musulmans asservis avaient également disparu en raison de la manière dont le commerce transatlantique des esclaves séparait les familles africaines. Puisque c’étaient principalement les hommes que l’on vendait et que l’on déportait, soit ils n’avaient pas d’enfants, soit ils finissaient par épouser des non-musulmanes. Même dans des pays comme le Brésil, qui avaient de fortes et larges communautés musulmanes d’Africains qui avaient été asservis puis libérés, transmettre leur foi à leurs enfants devenait difficile, puisque les jeunes générations percevaient l’Islam comme une religion « austère » qui allait les positionner comme une minorité et « il était plus ‘marrant’ dans ce cas – pour recourir à une terminologie moderne – d’être chrétien », faisait remarquer Mme Diouf.
Mais il y a des raisons pour lesquelles le blues n’a pris racine qu’aux États-Unis, et non dans les autres colonies. Là, les Ouest-Africains asservis recréèrent les instruments à cordes sur lesquels ils avaient joué pendant des centaines d’années, comme le banjo, ou différentes sortes de luths ou encore le violon, qui évolua finalement en guitare. Et quand les non-musulmans entendaient l’adhan (appel à la prière), les chants soufis et les duas (supplications) ou lamentations, ils les percevaient comme un autre type de musique africaine, qu’ils finirent par imiter et propager. Des décennies plus tard, ces pratiques, fusionnées avec d’autres traditions musicales africaines, évoluèrent pour former les cris et les braillements qui aboutirent au blues.
« Ce furent plus vraisemblablement des expressions audibles de la foi musulmane, et pas simplement ce que les musiciens ont apporté en plus, qui engendrèrent la musique distinctement afro-américaine du Sud »,
écrit Mme Diouf dans son essai. Un exemple frappant qu’elle met en lumière, c’est « Levee Camp Holler » (textuellement : La gueulante du camp de la digue, NdT), un air que les Afro-Américains jadis asservis chantaient tout en construisant les digues de la vallée du Mississippi dans l’Amérique de l’après-Guerre de Sécession.
« C’est presque exactement la même chose que l’appel à la prière lancé par un muezzin ouest-africain »,
écrit Mme Diouf.
« Quand on juxtapose les deux morceaux, il est difficile de distinguer quand l’appel à la prière se termine et quand démarre la gueulante. »
(Il est intéressant de faire remarquer que le premier muezzin fut un ancien esclave de l’Afrique orientale, désigné par le prophète Mahomet en personne.)
Ce style de chant, produisant des intonations nasales et vibrantes et des mélismes (expressions de plusieurs notes sur une seule syllabe), est toujours populaire dans le monde musulman. Dans la version d’Azraq de « Baby, Please Don’t Go », on peut les entendre dans les réverbérations de l’oud et dans les frémissements et secousses du chant de
Publié le 3 septembre 2021 sur +972 Magazine
Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine
Henriette Chacar est rédactrice en chef adjointe et journaliste à +972 Magazine, qui produit également le podcast du magazine. Précédemment, elle a travaillé pour un hebdomadaire du Maine, The Intercept, et à Rain Media pour PBS Frontline. Henriette est diplômée de l’Université de Columbia University, où elle a décroché une maîtrise en journalisme et en affaires internationales.