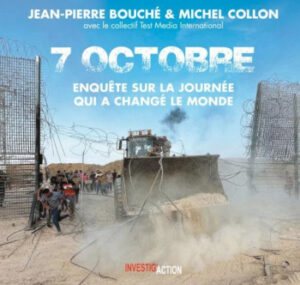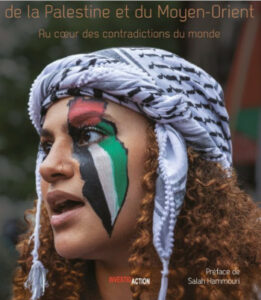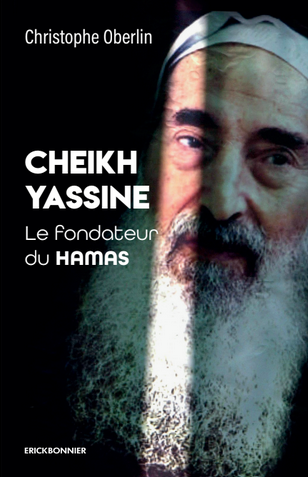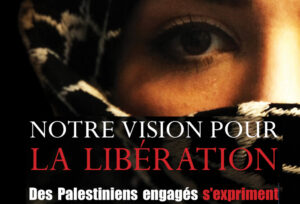Le terrain des fedayin : Le Hamas passe des tirs de roquettes symboliques à la tactique de la guerre d’usure
L’éthique inflexible des fedayin – qui veut que la résistance ne soit pas seulement tactique, mais sacrificielle, enracinée dans la volonté inébranlable de donner sa vie pour une cause juste — a non seulement maintenu le mouvement en vie, mais a fait de son endurance un témoignage.

La proximité comme force : « À distance zéro » est devenu à la fois un descripteur tactique et un procédé rhétorique utilisés pour affirmer que la résistance n’a rien d’abstrait ou de lointain, mais qu’elle est viscérale, solidement incarnée et inébranlable.
Rima Najjar, 13 juillet 2025
Contre toute attente, l’approche novatrice et courageuse du Hamas en matière de guérilla a tenu bon sous la puissance militaire combinée d’Israël et des États-Unis. Par le biais de l’évolution tactique, d’embuscades rapprochées, de ses armes de fabrication locale et d’une éthique fedayin inflexible, la résistance a non seulement survécu, mais a également conservé le contrôle de terrains clés, influencé les négociations de cessez-le-feu et contrarié les objectifs stratégiques d’Israël.
Cette endurance sur le champ de bataille a marqué un tournant stratégique en octobre 2023, lorsque le Hamas a réorienté ses tactiques vers une résistance plus décentralisée, basée sur la guérilla. Sa capacité à régénérer ses forces, à s’adapter rapidement aux conditions sur le champ de bataille et à imposer des coûts aux unités d’élite de l’armée israélienne, est la preuve d’un niveau de résilience opérationnelle que peu de gens auraient prévu. Ce qui devait être une éradication rapide s’est transformé en un affrontement prolongé, où l’endurance du Hamas sur le champ de bataille se répercute désormais comme un levier politique.
Au début de son évolution militaire, le Hamas s’appuyait sur une résistance symbolique : des tirs de roquettes et des déclarations témoignant davantage de défiance que d’efficacité sur le terrain, notamment lors de conflits comme les opérations « Plomb durci » et « Bordure protectrice ». Ces gestes visaient à résister, à affirmer sa présence et à conserver sa légitimité politique en situation de siège.
Mais depuis l’offensive d’octobre 2023, ce paradigme a changé. Le Hamas a adopté une tactique d’usure, en déployant des engins explosifs improvisés sophistiqués, des frappes antichars à courte portée et des manœuvres de guérilla adaptatives afin d’infliger des dégâts mesurables et contester des territoires. Sa stratégie vise désormais non seulement à survivre, mais aussi à contrecarrer les opérations israéliennes et à atteindre des objectifs militaires concrets, même au prix d’un coût extraordinaire.
L’arsenal du Hamas — constitué de roquettes produites localement comme les Qassam et les Sejjil, de missiles antichars Yassin-105, de mortiers, d’armes légères et d’engins explosifs improvisés — témoigne d’une ingéniosité tactique forgée sous le siège. Des ateliers secrets à travers Gaza continuent de produire des armes malgré les frappes aériennes israéliennes incessantes sur les sites de production. Les conceptions s’adaptent rapidement aux besoins du champ de bataille, une résilience devenue essentielle à la stratégie de la résistance.
Les munitions à courte portée et à grande mobilité dominent désormais la stratégie tactique du Hamas. Dans le contexte urbain dense de Gaza, elles permettent des embuscades et des frappes rapides contre les véhicules blindés et l’infanterie. Les engins explosifs improvisés (EEI) ont évolué, avec des charges creuses, pour percer les blindages israéliens, tandis que des rapports de combat suggèrent des techniques empruntées au Hezbollah, comme des explosions secondaires à retardement qui visent les équipes de secours.
Le passage de la défiance symbolique à l’usure tactique a profondément remodelé le paysage du cessez-le-feu. Le Hamas ne négocie plus en position de désespoir ou de simple survie : il exploite la résilience sur le champ de bataille en tant que capital politique.
Malgré des pertes catastrophiques, le Hamas a fait preuve d’une capacité opérationnelle soutenue en tendant des embuscades aux forces israéliennes, en réoccupant des zones « nettoyées » et en maintenant sa production d’armes malgré l’état de siège. Cela a contraint Israël à revoir ses objectifs de guerre. Alors que le Premier ministre Netanyahou avait initialement promis d’« éliminer le Hamas », ses récentes déclarations privilégient désormais la libération des otages et laissent entrevoir une certaine flexibilité diplomatique.
Le contraste, dans la portée des combats, entre Israël et le Hamas et ses factions alliées est saisissant. Les armes du Hamas ne sont efficaces qu’au contact : les combattants doivent ramper à travers les ruines, s’approcher des chars et poser manuellement des explosifs, souvent sous des tirs directs. Ces actes ne sont pas de simples manœuvres tactiques ; ils incarnent le courage, une résistance prête à tout risquer pour chaque mètre de terrain.
Par contre, les forces israéliennes restent essentiellement aériennes : avions, drones et tirs d’artillerie à distance, isolés du terrain. Là où le Hamas affronte le pouvoir en face, Israël exerce sa domination d’en haut. Les fedayin combattent non seulement par leur présence physique, mais aussi selon des convictions gravées dans leur corps : leur endurance, leur mémoire et leur refus de céder deviennent des armes en elles-mêmes dans une guerre d’anéantissement asymétrique.
En mai 2025, Israël a opté pour des opérations statiques, lourdes en artillerie dans le cadre d’une campagne baptisée « Les Chariots de Gédéon », enlisant finalement ses forces dans les décombres de Gaza. Mais les tactiques de proximité du Hamas continuent de causer des pertes, exploitant la résistance incarnée (leurs corps sont leurs chariots) pour transformer le courage et le terrain en atouts stratégiques. Le combat s’est ainsi transformé en une épreuve d’endurance politique, où la simple survie du Hamas est devenue son principal atout.
L’étonnante endurance du Hamas sur le champ de bataille a permis les négociations de cessez-le-feu, mais les a également compliquées. En survivant, et en surpassant à certains égards un adversaire militairement largement supérieur, le Hamas aborde les négociations non pas en vaincu, mais en position d’influence. Cette inversion alimente un paradoxe : la résilience de l’organisation, autrefois un argument de son endiguement, exige désormais des concessions politiques. Ainsi, les propositions actuelles de cessez-le-feu prévoient des retraits israéliens progressifs, des échanges d’otages et même des cadres de gouvernance d’après-guerre.
Le passage du Hamas à l’usure tactique a transformé son rôle dans les négociations de cessez-le-feu et dans les calculs politiques plus larges. Après avoir survécu à des mois de guerre intense et démontré sa résilience opérationnelle, il négocie désormais en position de force : il exige le retrait total d’Israël, rejette le désarmement et s’affirme comme un acteur légitime.
Cet effet de levier remet directement en cause la prétention de l’Autorité palestinienne à une gouvernance exclusive, la crédibilité du Hamas sur le terrain dépassant l’influence diplomatique de la même AP à Gaza. Les médiateurs internationaux sont de plus en plus contraints de tenir compte de l’influence du Hamas, et les propositions de modèles de gouvernance hybride ou de supervision technocratique suggèrent qu’il pourrait chercher à exercer un contrôle politique indirect tout en conservant sa position militaire.
Au niveau régional, cette endurance a perturbé les plans israéliens et américains pour une Gaza de l’après-Hamas, tout en renforçant la position du Hamas parmi les segments de la population palestinienne et des publics arabes sympathisants.
Les médiateurs sont de plus en plus contraints de tenir compte de l’influence du Hamas, du fait que ce groupe demeure un acteur central tant dans la dynamique sur le terrain que dans l’issue des négociations. En voici des exemples concrets :
–Engagement direct des médiateurs : Le Hamas a soumis une « réponse positive » aux propositions de cessez-le-feu du Qatar et de l’Égypte, indiquant sa volonté de négocier des conditions incluant le retrait des FDI et des garanties humanitaires. Les médiateurs ont reconnu le rôle du Hamas en poursuivant les pourparlers de proximité à Doha, Israël envoyant une délégation malgré le rejet public des amendements proposés par le Hamas.
–Reconnaissance par les États-Unis du rôle du Hamas : Le président Trump a déclaré que « le Hamas souhaite un cessez-le-feu » et a souligné que l’accord ne s’améliorerait pas si le Hamas le rejetait. Les États-Unis auraient également proposé des garanties au Hamas, par l’intermédiaire de médiateurs qataris, que la guerre ne reprendrait pas après une trêve de 60 jours – une reconnaissance tacite du pouvoir de négociation du Hamas.
–L’influence des otages : Le contrôle continu du Hamas sur les otages a contraint Israël et les acteurs internationaux à dialoguer directement avec lui. L’organisation a utilisé des propositions de libération échelonnée des otages pour façonner les conditions du cessez-le-feu, notamment des demandes d’échanges de prisonniers et de retrait territorial.
–Contrôle territorial : Malgré les opérations israéliennes prolongées, le Hamas conserve le contrôle du centre de Gaza, notamment de zones stratégiques comme Nuseirat et Deir el-Balah. Ce contrôle lui permet de réaffirmer sa domination tactique et d’influencer la distribution de l’aide, renforçant ainsi son rôle dans les négociations.
L’évolution du Hamas, passant d’une résistance symbolique à une usure tactique, a bouleversé les rapports de force traditionnels. En forçant Israël à s’engager dans un conflit prolongé sans issue claire, l’organisation s’est assuré un rôle dans le modelage de l’avenir de Gaza, que ses adversaires le reconnaissent ou non. La question n’est plus de savoir si le Hamas participera aux négociations d’après-guerre, mais à quelles conditions.
En fin de compte, l’évolution du Hamas ne se heurte pas seulement à des paradigmes militaires, mais aussi à des certitudes politiques. Sa place dans l’avenir de Gaza n’est plus hypothétique ; elle est ancrée dans les décombres, dans la résistance et dans les négociations qui en découlent.
*****
 Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.
Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.
*****
Publié le 12 juillet 2025 sur le blog de Rima Najjar
Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine
Lisez également ces articles de Rima Najjar, publiés sur ce site :
Génocide et déplacement en tant que négociation : la logique immuable du Plan Dalet
La dignité comme levier : Un contre-cadre pour les négociations des prisonniers palestiniens
Ce qui se cache derrière les retombées de Glastonbury
Le paradoxe de la philosophie israélienne de la « victoire totale »
Oum Kalthoum, l’Iran et les gouvernements et médias occidentaux
La Palestine et l’Iran peuvent être durement touchés et continuer d’aller de l’avant
Exiger une justice qui transcende la destruction
La Résistance palestinienne à l’action à Bruxelles